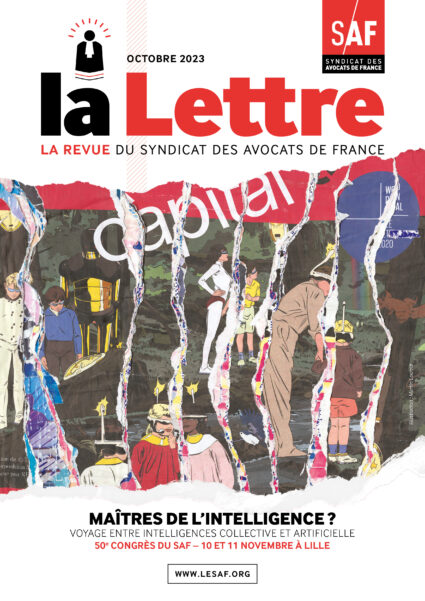Au printemps de l’année 2023, une équipe de 10 avocates dont je faisais partie, s’est rendue à Mayotte, département d’outre-mer dans un triple but : dresser un constat sur la situation de l’accès au droit, recueillir des informations quant aux violations des droits fondamentaux des personnes éloignées de force par l’État français, défendre les populations visées par la démolition de leur habitat, sans solution de relogement.
Cette mission que Gérald Darmanin a qualifié de « tourisme juridique »¹, que l’avocat du préfet de Mayotte a accusée de mener une campagne d’« hystérisation juridictionnelle collective » et d’être composée par des « artificiers du chaos », a tout simplement essayé de faire valoir les droits reconnus par la Constitution et les textes internationaux de toute personne vivant en France. Sans succès, in fine, ou avec un succès très relatif.
Majicavo Talus II
En effet, le lundi 24 avril 2023, pour la première fois depuis le début des opérations de démolition de quartiers pauvres, la parole a été donnée aux habitants du quartier Majicavo Talus II. Ces citoyens, dont les logements devaient être détruits le lendemain à l’aube, ont pu exprimer devant la présidente du tribunal judiciaire leurs revendications et ont été entendus. Le temps d’une audience, ils.elles ont retrouvé la dignité que l’État français avait piétinée. Un souffle pour des personnes dont on étouffe les droits. Avec force et courage, les habitant.e.s de Talus II ont écrit une page de l’histoire des luttes sociales à Mayotte.
Malheureusement, force a été de constater que le sort des habitants les plus pauvres de ce département, qu’ils soient français ou non, n’intéresse ni l’État central, ni les élites mahoraises, prêtes à sacrifier leurs voisins et cousins pour des intérêts fonciers, économiques ou encore politiques.
Ainsi, sont laissées littéralement à l’abandon les personnes qui sollicitent une protection internationale, parmi lesquelles des femmes enceintes et enfants en bas âge. Sans autre alternative, des familles entières se regroupent autour des locaux de l’association chargée de les héberger dans l’espoir qu’une place se libère. En attendant, elles dorment à même le bitume dans des conditions d’hygiène déplorables. Elles sont contraintes de cuisiner des rations de guerre sur des popotes de fortune, de se protéger du soleil et de la pluie sous des bâches de plastique. Leur sécurité n’est même pas assurée. Récemment, les demandeurs et demanderesses d’asile ont fait l’objet d’attaques ciblées par des collectifs anti-immigration. L’État français reste impassible.
Des enfants abandonnés
Plusieurs milliers d’enfants en âge d’être scolarisés ne le sont pas. Comme l’a relevé le défenseur des droits, le dispositif dérogatoire des « classes itinérantes » mis en place par le rectorat de Mayotte « ne remplit pas les conditions d’un accès effectif au droit à l’instruction ». Avec un volume horaire trois fois inférieur à celui d’une classe normale, la classe itinérante ne peut bénéficier de son droit à l’éducation tel qu’inscrit dans la convention internationale des droits de l’enfant, la CIDE.
La célérité avec laquelle le préfet de Mayotte met à exécution les mesures d’éloignement, a pour conséquence de fabriquer des mineurs isolés. Rentrant de l’école, des enfants se retrouvent seuls à la maison, les parents ayant été raflés par la police un peu plus tôt dans la journée.
L’économie locale sinistrée n’offre aucune possibilité pour les jeunes diplômés. Pour celles et ceux qui sont titulaires d’un titre de séjour délivré par la préfecture de Mayotte, il est impossible d’envisager une installation dans un autre département sans obtenir au préalable « l’autorisation spéciale » dont les contours restent très opaques et qui de fait les enferme dans les frontières de l’archipel. Une bombe à retardement qui ne peut que plonger plus avant Mayotte dans le chaos.
Une politique de destruction sociale
Depuis bientôt trois ans, le préfet de Mayotte n’a de cesse de démolir des quartiers d’habitats dits « informels » où résident ensemble des familles françaises, comoriennes, malgaches ou africaines, qui ont très souvent comme point commun de ne pas remplir les critères d’accession à un logement social. Des familles entières sont ainsi mises à la rue sans qu’une solution pérenne soit trouvée et qu’elles puissent bénéficier d’un relogement digne leur permettant de maintenir la scolarité de leurs enfants, conserver leur biens meubles mais également leur activité économique.
 L’opération Wuambushu déployée à grands renforts de tambours médiatiques par le ministre de l’Intérieur n’est qu’une gesticulation démagogique visant à faire croire que l’État garantit la sécurité de la population à Mayotte. Prétendre que 500 gendarmes supplémentaires vont pallier les carences systémiques des services publics à Mayotte est un mensonge cruel pour les victimes quotidiennes de cette guerre contre les pauvres que l’État a décidé de mener à Mayotte.
L’opération Wuambushu déployée à grands renforts de tambours médiatiques par le ministre de l’Intérieur n’est qu’une gesticulation démagogique visant à faire croire que l’État garantit la sécurité de la population à Mayotte. Prétendre que 500 gendarmes supplémentaires vont pallier les carences systémiques des services publics à Mayotte est un mensonge cruel pour les victimes quotidiennes de cette guerre contre les pauvres que l’État a décidé de mener à Mayotte.
Certaines bonnes volontés essayent de résister à l’injustice. Mais le processus de déshumanisation à l’œuvre balaye toute opposition, se nourrissant de discours de haine et violence qui pourraient rappeler ceux de l’odieuse radio rwandaise des Milles Collines. Les statistiques prétendues alarmantes d’immigration incontrôlée justifient toute dérogation à l’État de Droit sur ce territoire et permettent à certains, dont le vice-président du conseil départemental, d’appeler au meurtre des jeunes « délinquants » sans qu’aucune réaction forte de l’État français ne soit visible, au contraire. En effet, les autorités continuent de pratiquer l’amalgame entre délinquance et immigration et ce faisant alimentent la haine de l’étranger.
Aucun des 27 avocats inscrits au Barreau de Mayotte n’ose revendiquer désormais publiquement la défense des étrangers ou des habitants des bidonvilles menacés par l’errance que les démolitions étatiques leur imposent.
Marjane Ghaem, avocate près de neuf années à Mayotte, qui a osé tenir tête publiquement à Estelle Youssoufa, députée locale qui fait de la haine de l’étranger son terreau électoral, a quitté l’île à la fin de l’année 2019 sous les menaces de mort, lassée de lutter seule contre une véritable machine de guerre qui broie les pauvres.
KAFKA
Les juristes, avocat.e.s ou juges, auxiliaires et gens de justice, celles et ceux pour qui le droit et les mécanismes de protection des droits sont des principes intangibles, se heurtent à l’absurdité dans laquelle la raison d’État a réduit ces principes fondamentaux tel Joseph K. dans Le Procès de Kafka. Nous souhaiterions nous réveiller de ce cauchemar dystopique.
Que peut-on espérer pour l’État de droit à Mayotte si l’existence même de ce département est issue d’une violation flagrante du droit international public ? L’assemblée générale des Nations Unies s’est lassée de condamner la France à la suite de l’annexion illégale de Mayotte lors de l’indépendance des Comores en 19752.
La condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Moustahi le 25 juin 2020 (affaire 9347/14) n’a rien changé aux pratiques indignes que l’État français emploie pour afficher des statistiques impeccables et implacables de lutte contre l’immigration à Mayotte : contrôle d’identité au faciès ; rattachements arbitraires de mineurs à des adultes sans lien de filiation se trouvant sur les kwassa kwassa (canots de pêche) en provenance des Comores ; éloignement expéditif des parents vers les Comores laissant des enfants seuls sur le territoire sans aucun représentant légal ; refus catégorique des autorités d’examiner les situations personnelles pour pouvoir éloigner massivement en un temps record toute personne interpellée qui se trouve sans justificatif de droit au séjour même si cette personne est de nationalité française, titulaire d’un titre de séjour ou est demanderesse d’asile. Comment sinon pouvoir éloigner chaque année 30 000 personnes pour un territoire d’environ 500 000 habitants ? La durée moyenne de rétention administrative n’est que de 17 heures.
Exceptée la procédure de référé liberté, extrêmement exigeante, aucun mécanisme juridique ne permet de bloquer un éloignement de façon effective puisque les recours contre les mesures d’éloignement ne sont pas automatiquement suspensifs.
La mesurette que l’État français a prise à la suite des condamnations par la CEDH dans l’affaire Moustahi, mais également dans l’affaire De Souza Ribeiro n°22689/07 du 13 décembre 2012, qui consiste à laisser la responsabilité au juge administratif d’interrompre la machine à éloigner, en décidant de l’opportunité d’organiser une audience lorsqu’il est saisi en référé, met l’institution juridictionnelle administrative en surchauffe face aux pressions politiques. Pourtant, seules 4 000 requêtes en 2022 ont permis d’interrompre l’éloignement et ont conduit le juge judiciaire à sanctionner à quasi 100 % les interpellations et privations de liberté totalement illégales qui se produisent systématiquement à Mayotte.
Et le Conseil constitutionnel ?
Il cautionne toutes les dérogations souhaitées par le législateur ou le Gouvernement motif pris de l’« impérieuse nécessité » de la lutte contre l’immigration provenant des Comores. Impérieuse ou impériale ? Quelle nécessité ? Comment qualifier d’illégaux les mouvements de population dans un archipel qui est un ensemble géographique homogène depuis des siècles ? Quelle ambition irrationnelle que de vouloir empêcher la liberté de circuler des êtres humains !
Il est certain que l’État de droit n’existe pas à Mayotte. Si la République française souhaite revendiquer la souveraineté de Mayotte, à tout le moins, elle doit cesser de déroger au droit métropolitain. Le « risque migratoire » que cette île représente est dérisoire en comparaison de l’indignité dans laquelle les êtres humains qui y habitent. Leurs droits sont constamment restreints par un jeu de dérogations.
La France se satisfait d’une politique sécuritaire à courte vue alors qu’aucun avenir n’est possible pour Mayotte et ses habitants sans une coopération dynamique avec tout l’archipel des Comores.
Les pauvres de ce département français d’outre-mer en l’état continuent donc de payer le prix fort d’une colonisation qui ne dit pas son nom.
Notes et références