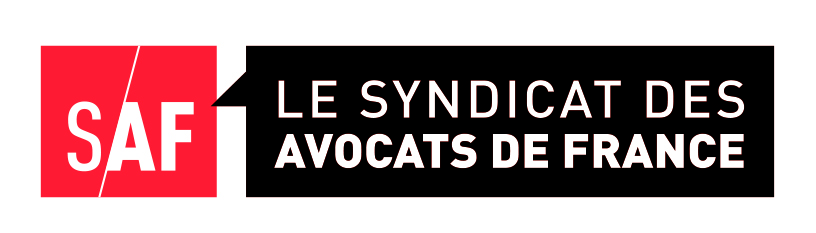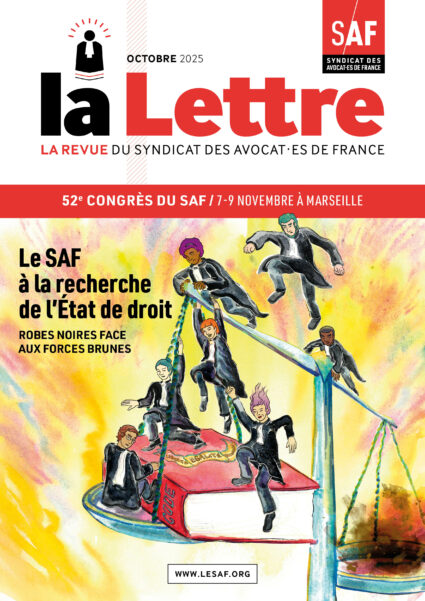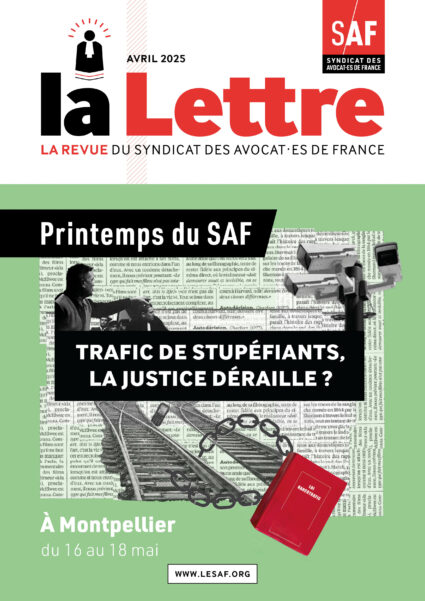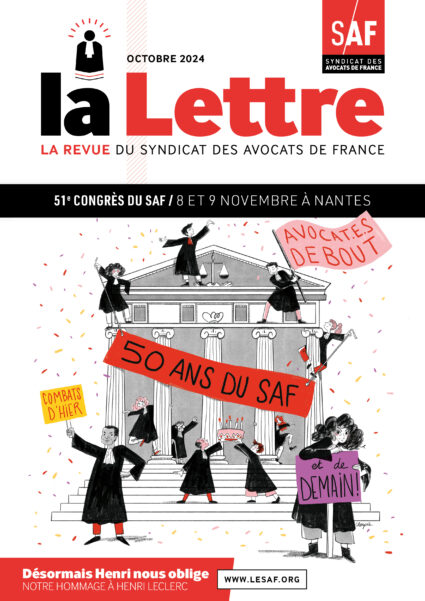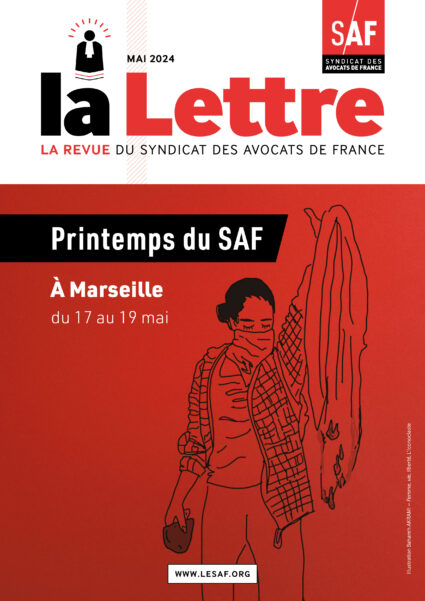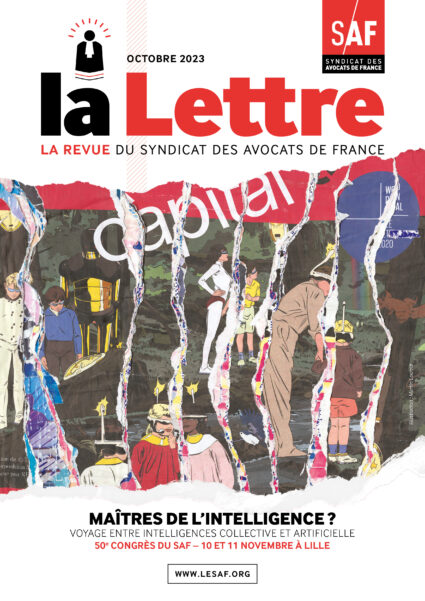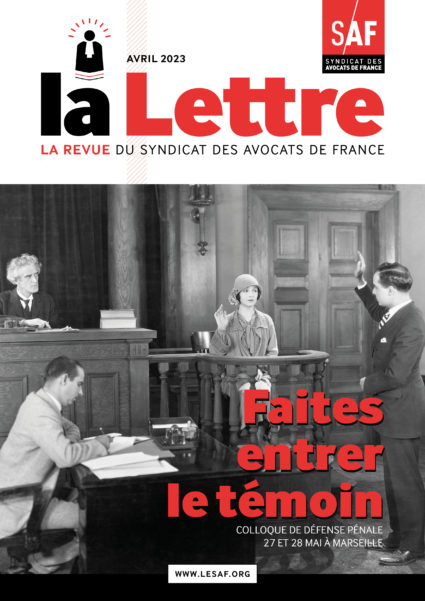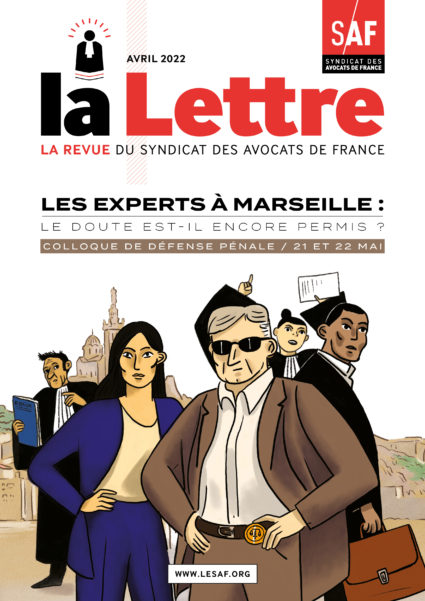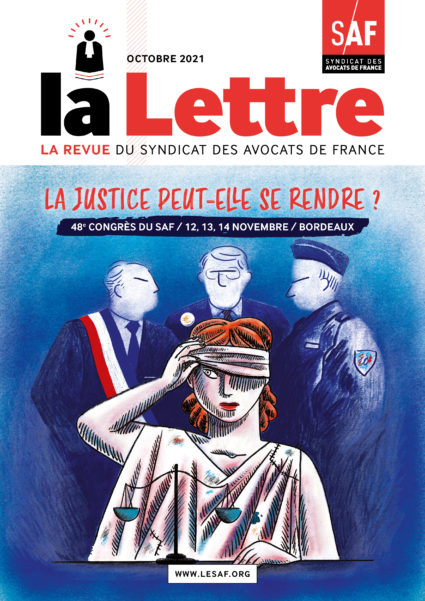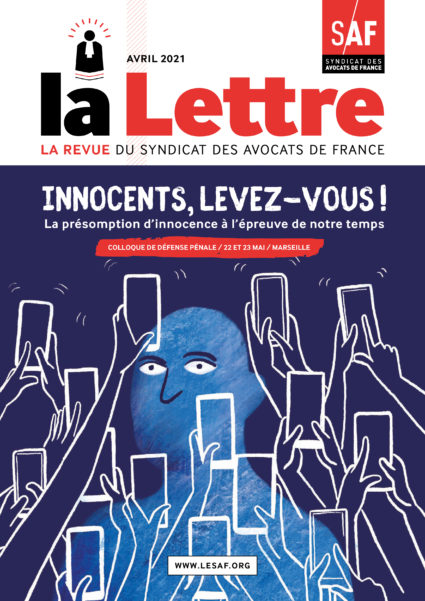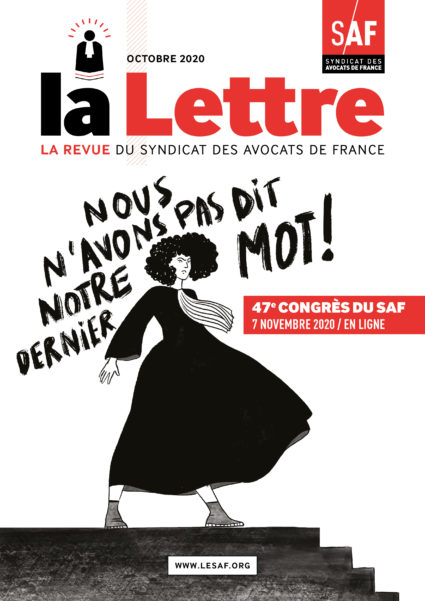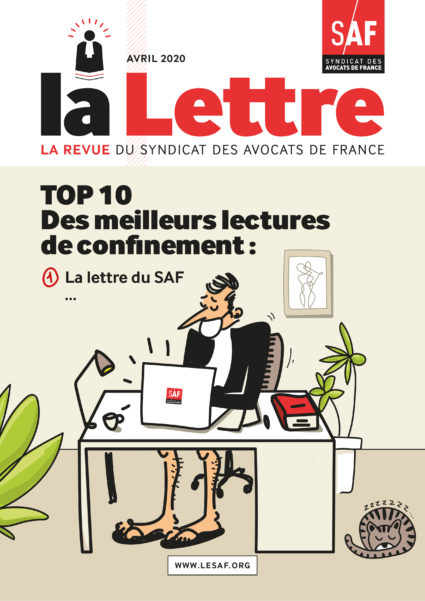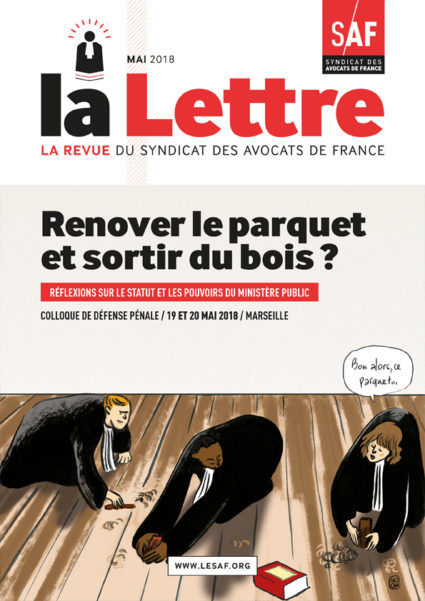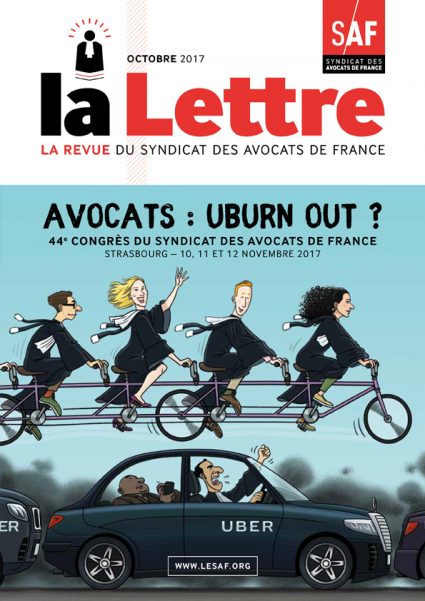Sophie-Anne Bisiaux est l’autrice de En finir avec les idées fausses sur les migrations aux éditions de l’Atelier.
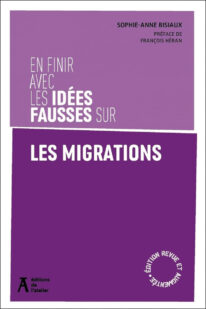 SAF : Qu’est-ce qui vous a motivé à déconstruire les idées reçues sur les migrations ?
SAF : Qu’est-ce qui vous a motivé à déconstruire les idées reçues sur les migrations ?
SB : L’immigration est un sujet très politisé, qui revient à chaque élection, donnant lieu à des débats très clivants et beaucoup d’instrumentalisations. À ces occasions fusent dans les discours et les médias de nombreux préjugés alimentant peurs et intolérance. Cette tendance s’observe partout et se renforce ces dernières années.
Mais alors que la fermeture des frontières est justifiée par les politiques par une prétendue « volonté populaire », lorsqu’on y regarde de près, on voit que la migration n’est pas la préoccupation des français·es et qu’iels entretiennent un rapport ambivalent avec ce sujet. Mais surtout, on constate qu’il existe une corrélation forte entre connaissance et opinion.
C’est de l’ambition de lutter contre ces préjugés qu’est né ce livre, en donnant à tout.es les moyens de s’informer, de s’armer contre les idées fausses, et de se forger une opinion basée sur des faits.
SAF : Pensez-vous que les médias jouent un rôle dans la propagation des idées fausses sur les migrations ?
SB : De fait, de nombreux médias relaient des informations erronées et participent à banaliser dans l’opinion publique les idées d’« appel d’air », de « submersion migratoire », de « grand remplacement »… En sur-visibilisant les actes de délinquance commis par des étranger·ères, certains participent par exemple à associer dans l’imaginaire collectif migration et insécurité.
Diverses expériences montrent qu’il existe des manières assez simples permettant d’éviter cet écueil. En 2016, un journal allemand a décidé de systématiquement révéler l’origine des auteur.trices d’infraction, étrangères ou non. Exposé·es à un plus grand nombre d’articles mentionnant des infractions commises par des nationaux, leurs lecteur·rices ont changé de perception, en associant moins migration et insécurité.
Les médias ont donc un rôle important à jouer pour lutter contre les préjugés. Non seulement en évitant toute manipulation politique de l’agenda médiatique mais en favorisant également un traitement équilibré de l’actualité reflétant les véritables préoccupations des citoyen.nes (la santé, les inégalités sociales, la crise climatique…). Cela implique de garantir le pluralisme et l’indépendance des médias, gravement mis à mal ces derniers temps.
SAF : Vous proposez des alternatives comme la liberté de circulation. Comment répondre aux critiques qui jugent ces idées irréalistes ?
SB : Le travail de déconstruction des préjugés ne peut se cantonner au terrain du vrai et du faux. Il requiert d’une part de se demander à quelles fins un mensonge est proféré et de comprendre les intérêts que les discours xénophobes servent au sein d’une société inégalitaire marquée par le capitalisme et l’héritage de la colonisation, et d’autre part, d’élargir nos imaginaires politiques en s’intéressant aux alternatives fondées sur les principes de liberté et d’égalité des droits.
Parler de liberté de circulation, c’est refuser de se laisser imposer les termes du débat par l’appareil politico-médiatique dominant et promouvoir d’autres manières de penser visant à construire un monde plus égalitaire, plus juste, plus solidaire, prêt à surmonter les défis sociaux et environnementaux actuels et à venir.
Ces alternatives n’ont rien d’irréaliste. Tandis que la liberté de circulation est une réalité pour celles et ceux qui ne sont pas exclu.es du régime mondial d’apartheid des mobilités, la solidarité en acte aux frontières et au-delà montre qu’un accueil inconditionnel n’a rien d’une utopie !