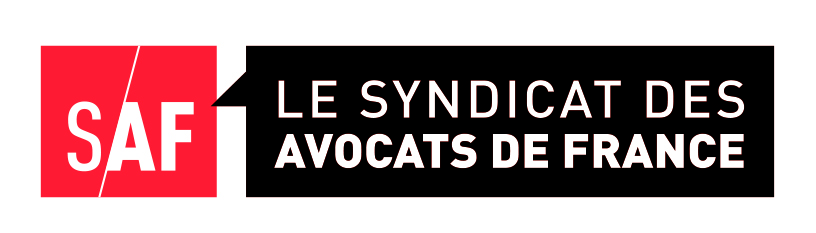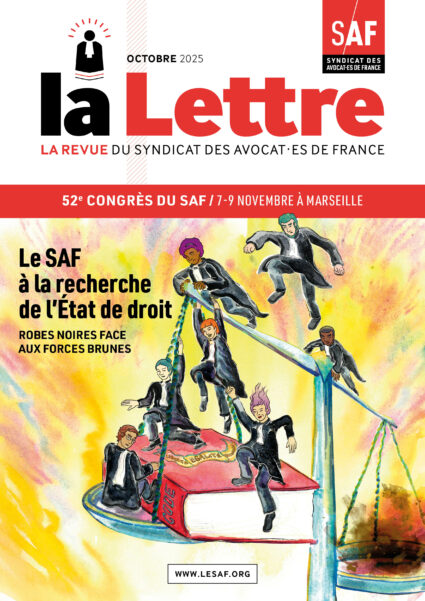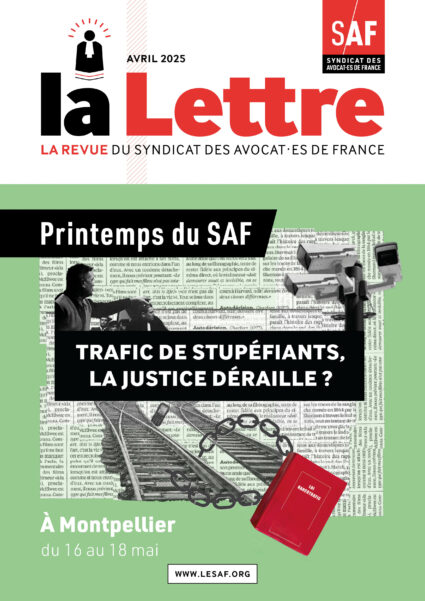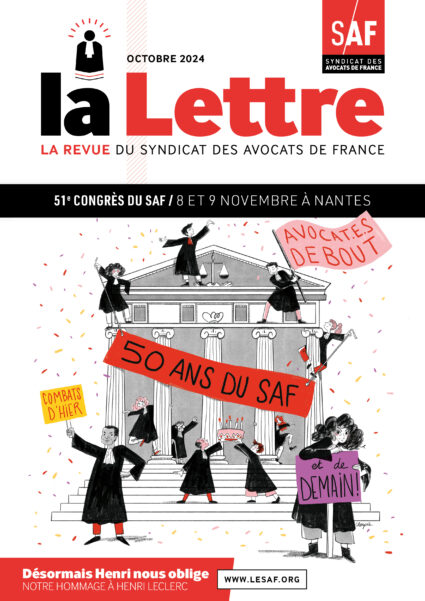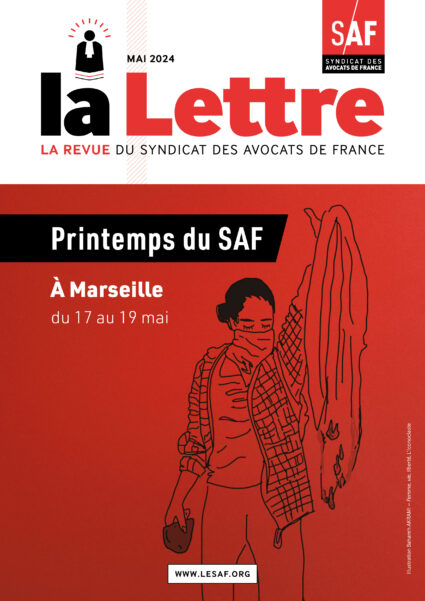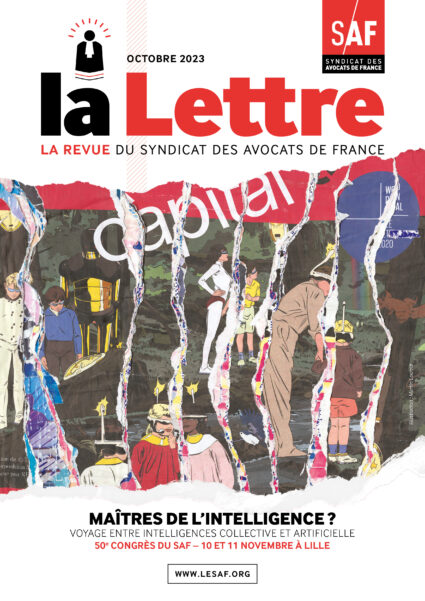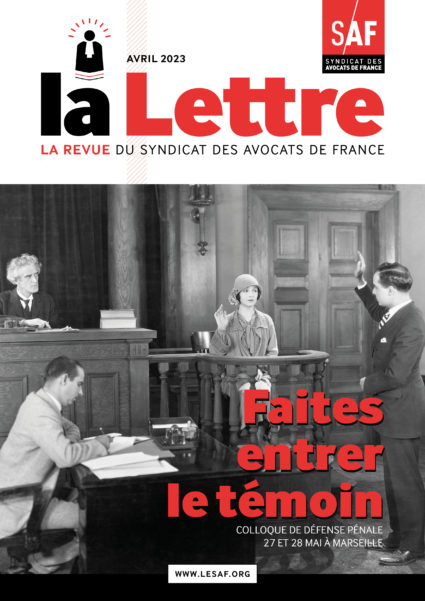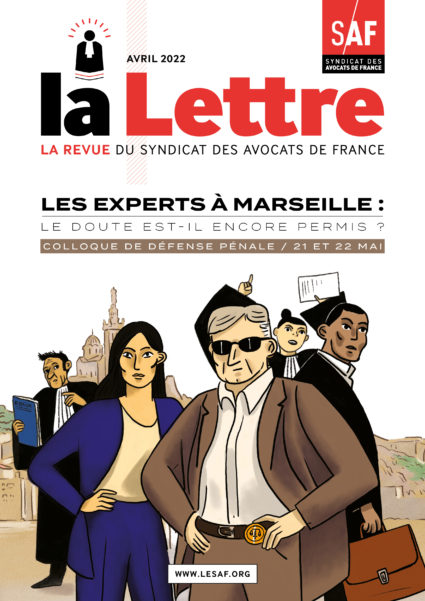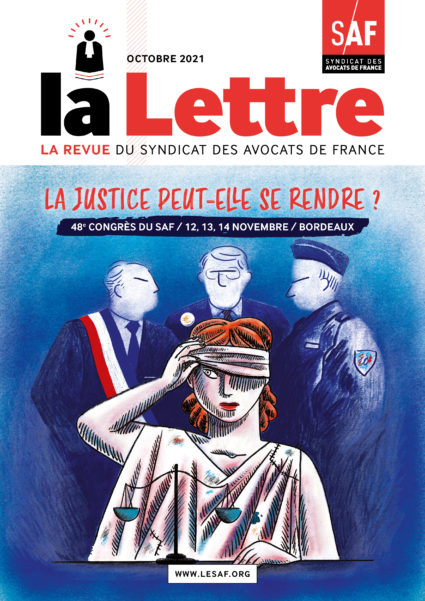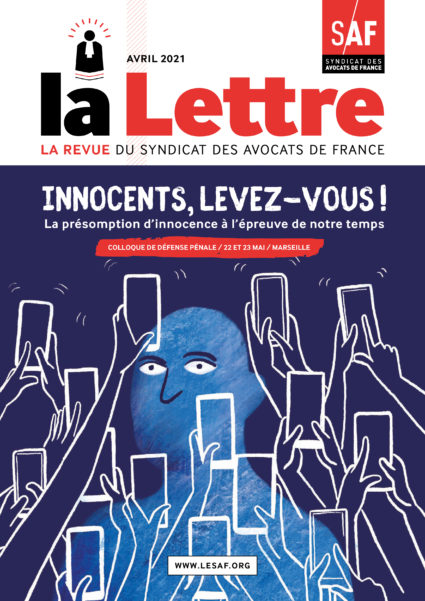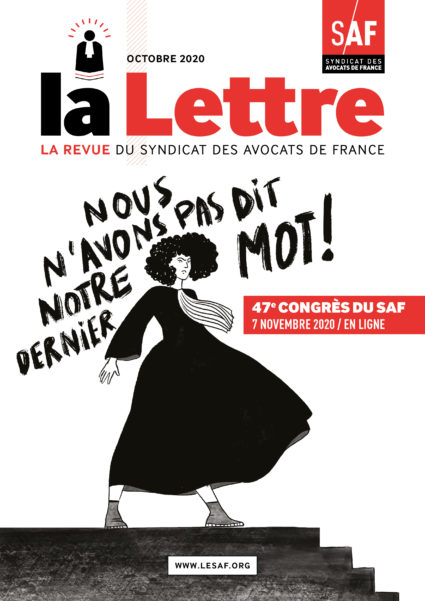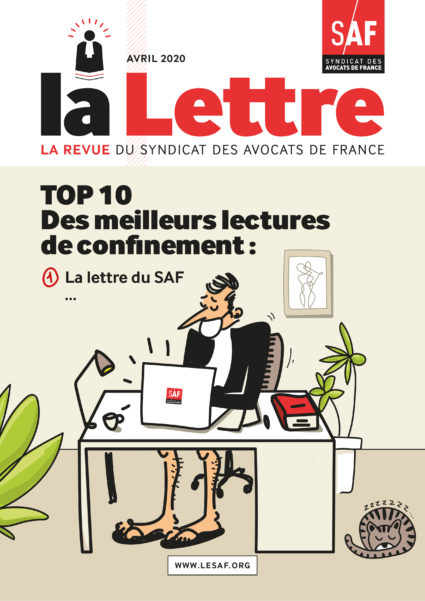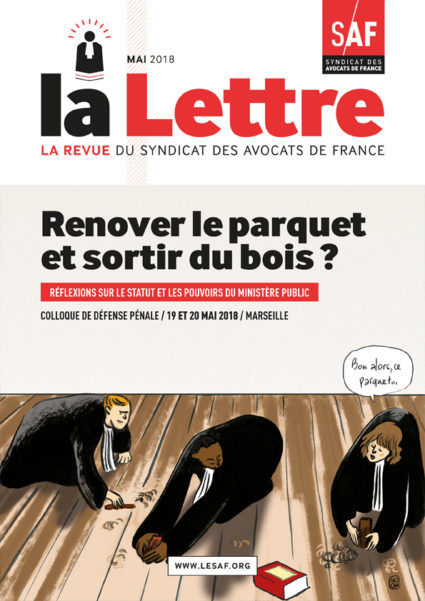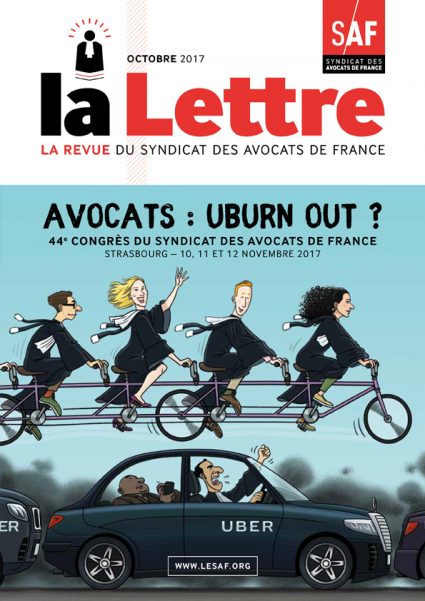La situation des avocat·es en danger confronté·es au recul de l’État de droit dans le monde n’a jamais semblé si critique en 2025.
En Amérique latine : l’exil comme porte de sortie
Sur la période 2024/2025, l’Observatoire international des avocats en danger (OIAD), institution qui fêtera ses 10 ans l’an prochain, rappelle la hausse continue et préoccupante du nombre d’avocat·es menacé·es dans leur exercice à travers le monde¹.Les avocat·es d’Amérique latine sont confronté·es depuis longtemps à l’absence d’indépendance du système judiciaire et à sa corruption endémique : pour Venus Faddoul (Vénézuéla), tout exercice « normal » du métier est impossible ; José Arnulfo Lopez (Nicaragua) subit la pression de groupes paramilitaires formés pour harceler les défenseurs des droits humains ; Ana Katiria Suarez (Mexique) vit depuis 6 ans sous protection judiciaire ; Andrea del Rocio Torres (Colombie), engagée dans la défense de l’environnement, exerce sous surveillance policière et sous la pression des multinationales qui suivent les avocats des droits de l’Homme.
Nos confrères et consœurs témoignent des menaces permanentes de radiation ou de suspension de leurs propres ordres. En dernière instance, au risque de la dévitalisation des forces du pays, l’exil demeure la porte de sortie. Ils insistent sur l’importance de travailler en réseau d’avocat·es qui respectent les principes démocratiques et sur la nécessité de demander des comptes aux autorités de leurs pays.
 En Europe, l’affaiblissement des contre-pouvoirs
En Europe, l’affaiblissement des contre-pouvoirs
Si la situation demeure dramatique dans ces pays, l’OIAD relève « une augmentation notable » du nombre d’alertes dans le monde et en Europe. Les régimes dictatoriaux n’ont plus le monopole de l’instrumentalisation de la justice ni des poursuites iniques contre les avocat·es exposé·es, « même en démocratie, à des formes de répression plus insidieuses, mais tout aussi dangereuses ».
La multiplication des attaques contre l’indépendance de la justice et l’exercice libre des avocat·es émanant des régimes autocratiques, mais aussi des démocraties européennes elles-mêmes – « illibérales » ou non – offre un impressionnant nuancier des régressions des libertés et droits humains.
En Pologne, sous l’ère du PiS (« Droit et Justice » sic), le pouvoir judiciaire a été réorganisé. Les avocat·es proches des figures de l’opposition ont fait l’objet de surveillance illégale et de poursuites disciplinaires initiées à des fins partisanes. De son côté, la Hongrie actuelle de Viktor Orban a multiplié les réformes visant à restreindre l’indépendance des professions juridiques. Le conseil national de la justice est ainsi aujourd’hui sous contrôle politique et les barreaux régionaux font l’objet de pressions croissantes. Ces deux gouvernements ont choisi des stratégies d’épuisement et de délégitimation des avocat·es, sans recourir à des arrestations spectaculaires.
Si les méthodes sont multiples, elles ont un point commun : briser la séparation des pouvoirs, fondement de l’État de droit, que Mireille Delmas Marty synthétisait en ces termes : « pour que le pouvoir arrête le pouvoir il faut non seulement séparer les diverses sphères mais, avant tout, aménager des contre-pouvoirs. Or à mesure que la mondialisation se développe, la confusion des pouvoirs s’accroît, souvent accompagnée de la disparition des contre-pouvoirs ».
En Europe, la Cour européenne des droits de l’homme a fait l’objet de critiques récurrentes depuis sa création. Une étape a cependant été franchie cette année avec une attaque politique frontale de la part de neuf chefs de gouvernements européens emmenés par Giorgia Meloni, critiquant les décisions rendues à Strasbourg : « Il y a lieu de se demander si, dans certains cas, la Cour n’a pas étendu la portée de la Convention au-delà des intentions initiales de ses rédacteurs, modifiant ainsi l’équilibre entre les intérêts appelés à être protégés. Nous estimons que l’évolution de la jurisprudence de la Cour a, dans certains cas, limité notre faculté de prendre des décisions politiques dans le cadre de nos démocraties respectives et, partant, a affecté la manière dont nous, en tant que responsables publics, pouvons assurer la protection de nos sociétés démocratiques et de nos populations (…) »
Cette ingérence ne semble avoir suscité de réelles protestations que dans les cercles juridiques restreints. Elle représente pourtant une attaque d’ampleur inédite : « Il ne s’agit pas d’un exercice légitime de critique des décisions judiciaires, mais d’une atteinte à l’indépendance de la Cour qui ne peut qu’affecter gravement son bon fonctionnement par la négation de tous les principes qui fondent et légitiment l’État de droit »².
Turquie : la criminalisation méthodique du barreau
Cela fait désormais quelques années que les décisions rendues à Strasbourg n’impressionnent plus Ankara. Comment exercer son métier quand l’État de droit, ses garanties, ses fondements sont lentement et méticuleusement détricotés ?
Depuis le début des années 2010, le gouvernement turc n’a eu de cesse de poursuivre pour « complicité de terrorisme » des avocat·es engagé·es dans la défense de leurs client·es. Des vagues d’arrestations collectives, notamment au sein des organisations militantes telles que l’association des avocats progressistes (ÇHD), se sont succédées et se poursuivent en 2025.
Le régime d’Erdogan ne s’embarrasse pas de contre-pouvoir et cible les professions indépendantes : avocat·es, magistrat·es, journalistes, en vidant de leur contenu les dernières garanties procédurales. Depuis le « Coup d’État » de juillet 2016, la Turquie a maintenu une pression continue et une attitude intransigeante à l’encontre des avocat·es qui ne rentreraient pas dans le rang. Ebru Timtik, condamnée pour « appartenance à une organisation terroriste », privée d’un procès équitable, décédée en détention en juillet 2020 à l’issue d’une grève de la faim, a symbolisé cette lutte.
Sous la férule d’un nouveau procureur général d’Istanbul missionné par le pouvoir pour faire plier le barreau local, une procédure en révocation du bâtonnier et de son conseil de l’Ordre a été engagée début 2025. Des poursuites pénales ont aussi été initiée et un membre du conseil de l’Ordre a même été détenu quatre mois en détention provisoire sur la base d’un dossier vide, classé sans suite dix années auparavant.
Il est reproché au conseil de l’Ordre la diffusion d’une simple motion appelant au respect du droit international et à la mise en place d’une enquête impartiale après la mort de deux journalistes kurdes par des drones turcs. La procédure civile a conduit à la révocation du barreau et une procédure pénale est en cours contre le bâtonnier Kaboglu et ses membres du conseil de l’Ordre du barreau d’Istanbul, lesquels risquent plusieurs années de prison.
Une nouvelle convention européenne
La mainmise de l’exécutif et le dévoiement du pouvoir judiciaire, jusqu’à la suppression des garanties procédurales les plus élémentaires, apparaissent des corollaires indissociables des régimes autoritaires. De procédures déloyales en procès kafkaïens, les avocat·es sont ciblés et leur indépendance contestée.
À destination des avocat·es menacé·es, notre solidarité est requise, en poursuivant les observations de procès sur place et en renforçant les aides d’urgence existantes, tels que les programmes des « villes refuge » en France les proposent, pour nos confrères et consœurs contraint·es à l’exil.
À l’adresse des avocat·es européen·nes, il est urgent de diffuser et de s’approprier la nouvelle Convention du Conseil de l’Europe sur la protection de la profession d’avocat·e. Ouverte à la signature des États depuis le printemps, elle a constitué une excellente nouvelle en 2025 et une réponse indispensable aux menaces subies par la profession. Reste désormais à attendre et espérer la ratification et l’entrée en vigueur effective de ce nouvel instrument juridique contraignant protecteur des avocat·es.
Notes et références
1. Rapport d’activités 2024/2025 de l’OIAD – juin 2025.
2. Troisième édition des Printemps du Droit à Paris.