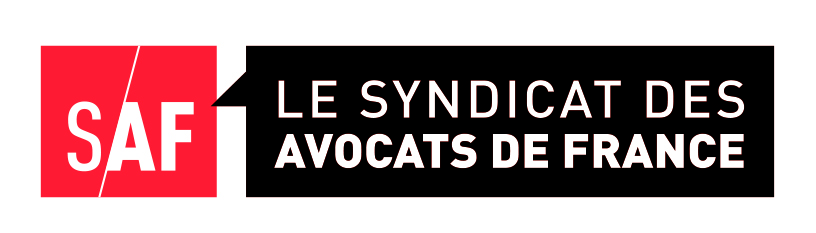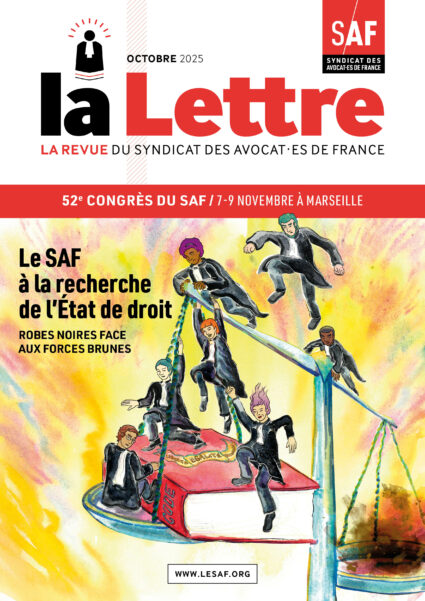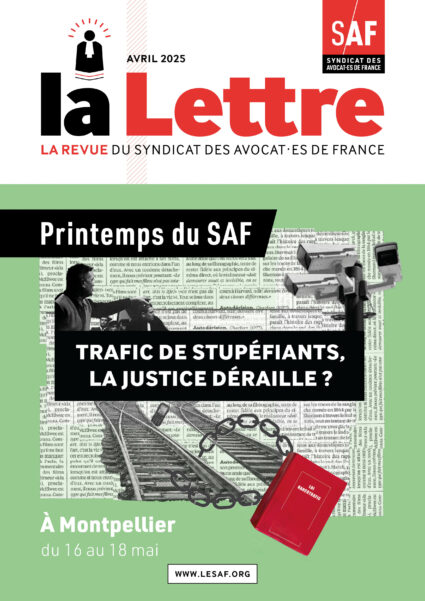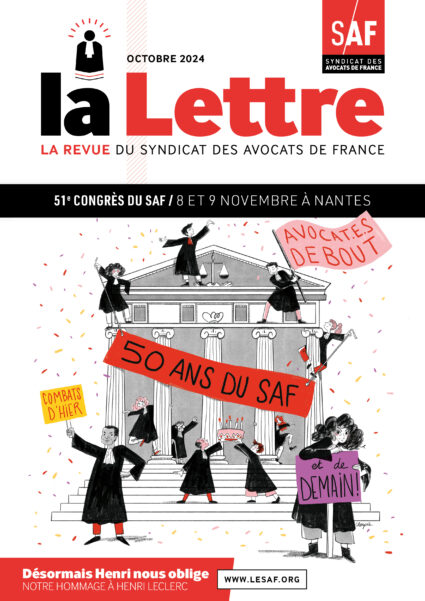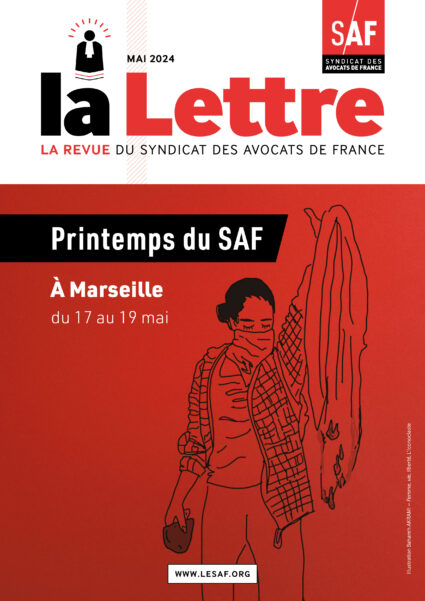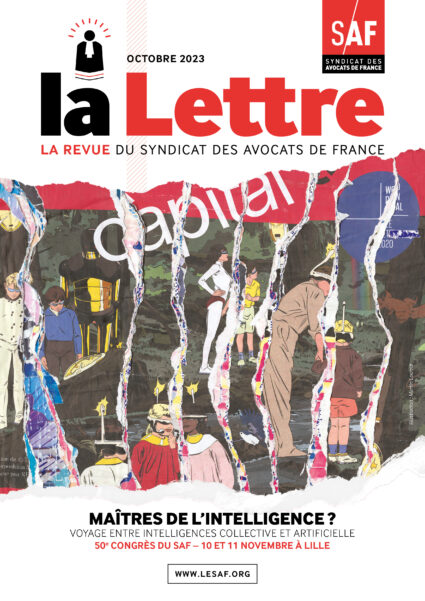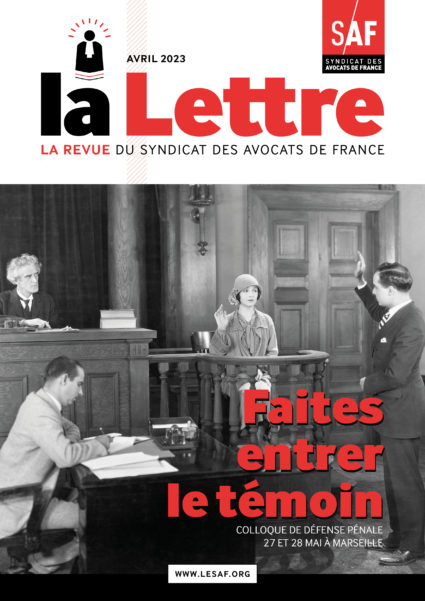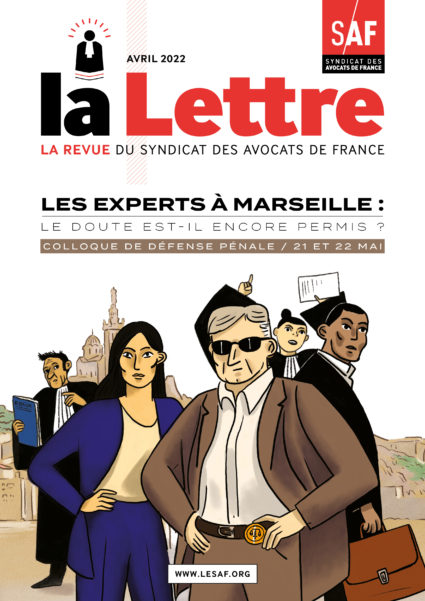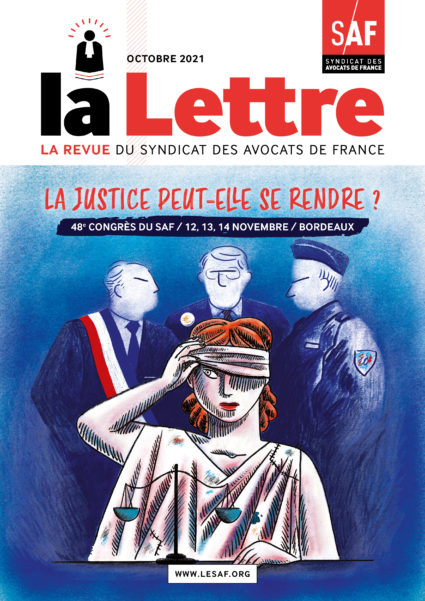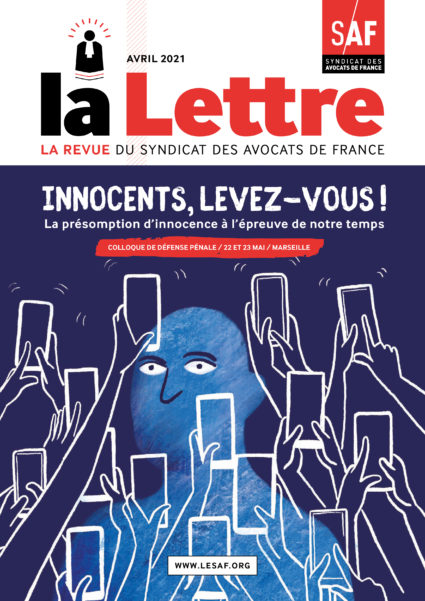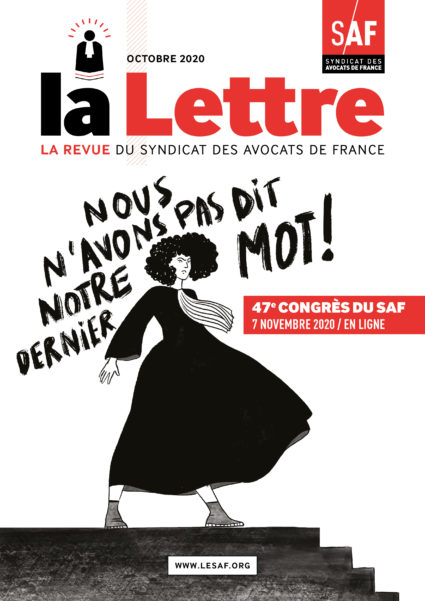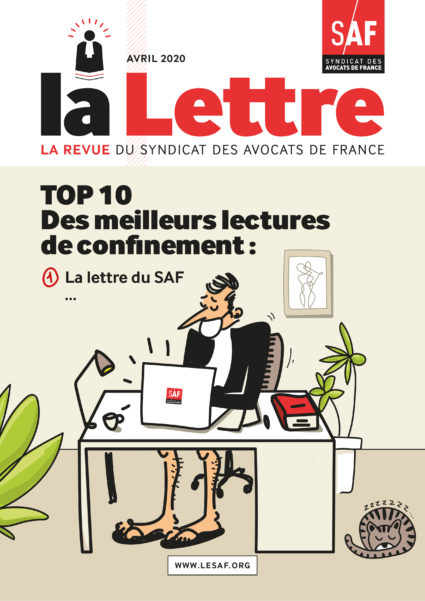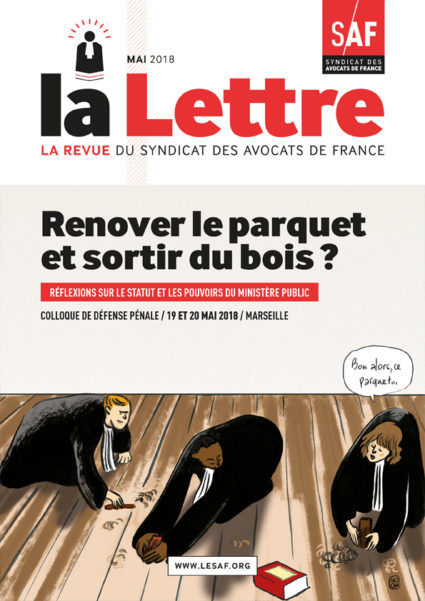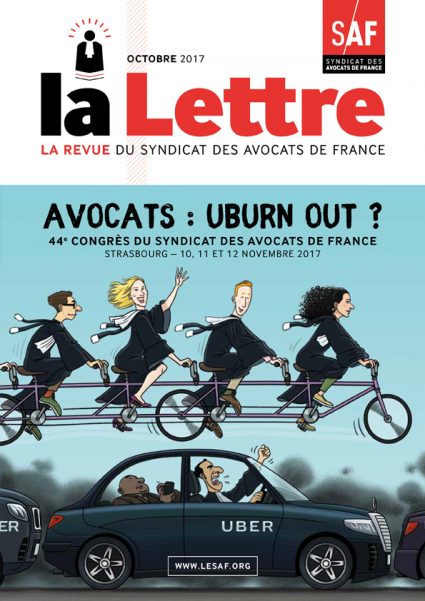La participation d’Aya Nakamura à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris a fait l’objet d’une tentative de polémique orchestrée par le groupuscule d’extrême droite les Natifs, recomposition et émanation de Génération identitaire. Cette affaire nous donne l’occasion d’évoquer certains aspects de la réponse pénale face aux propos à caractère raciste.
Pour rappel, Génération identitaire était un ancien mouvement de jeunesse d’extrême droite identitaire, nationaliste et xénophobe dont l’objectif était de rendre audible au sein de notre société la théorie du grand remplacement et promouvoir une idéologie incitant à la haine et à la violence envers les étranger·es et la religion musulmane. Le mouvement a été dissout en mars 2021, par décret. Le Conseil d’État a ensuite confirmé que cette décision était proportionnée au regard de la gravité des risques pour la sécurité publique que représentait l’association¹.
La performance artistique d’Aya Nakamura, accompagnée de l’Orchestre de la Garde républicaine, constituait un moment emblématique de la cérémonie d’ouverture des J.O. Pourtant, dès l’annonce probable de sa participation, les Natifs s’y opposaient en organisant une action de protestation sur les quais de Seine en mars 2025.
Les membres de cette organisation ont brandi une banderole affichant le propos suivant « YA PAS MOYEN AYA ICI C’EST PARIS PAS LE MARCHÉ DE BAMAKO » et diffusé un communiqué dénonçant une prétendue atteinte à l’identité culturelle et aux racines ancestrales de la France et l’éviction du peuple de souche en africanisant la chanson française, sans pour autant définir ces concepts².
L’action menée par les Natifs, s’inscrivant dans la stratégie classique de scandalisation propre aux mouvements d’extrême droite, visait à normaliser les discours racistes dans l’espace public en faisant passer ces propos pour un cri d’alarme, a conduit à une convocation des protagonistes devant le tribunal correctionnel de Paris pour provocation à la discrimination, à la haine et à la violence à l’égard d’Aya Nakamura en raison de son origine, de son appartenance ethnique et de sa race.
Il faut souligner qu’une fois n’est pas coutume, des moyens d’enquête importants ont été mis en place pour identifier et poursuivre les personnes mises en cause pour avoir tenu ces propos. Les prévenu·es ont même crié à la persécution d’État.
Il est regrettable qu’il ait fallu attendre que des propos racistes soient portés contre l’une des chanteuses les plus populaires de France, qui a de surcroît eu les grâces du président de la République, pour avoir une réponse ferme. La plupart du temps, il incombe aux associations de lutte contre le racisme et les discriminations et à leurs avocat·es de monter seul·es ces dossiers. Ne serait-il pas souhaitable que les moyens mis en place dans cette affaire le soient également pour toutes les victimes ? Cette affaire permet alors de s’interroger sur le fait de savoir s’il y a des victimes plus importantes que d’autres.
Au-delà d’une critique de l’action judiciaire en général, il est aussi important de se concentrer sur le fond de l’affaire.
En effet, les militant·es prévenu·es ont été poursuivi·es pour provocation publique à la discrimination, à la haine et à la violence sur le fondement de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881.
Depuis la loi dite Pleven du 1er juillet 1972, qui a établi instauré des dispositions de nature à lutter contre le racisme et l’antisémitisme, l’objectif est de protéger l’ordre public face à la diffusion de discours susceptibles de porter gravement atteinte à la cohésion nationale. Notre droit considère que de tels propos constituent un danger pour la société et justifient, sous le contrôle du juge, des restrictions à la liberté d’expression. Il s’agit aussi de protéger les personnes ou groupes de personnes visés face aux discours et actes discriminatoires, haineux ou violents, notamment en raison de leur origine.
Plus largement, la répression de cette infraction s’inscrit dans la protection de la dignité humaine, considérée comme une valeur fondamentale de l’ordre juridique français et européen.
L’enjeu de ce procès était donc de démontrer que les propos poursuivis constituaient une incitation à la haine. Pour cela, il était nécessaire d’établir que l’action des Natifs assignaient la chanteuse à ses origines maliennes et véhiculaient des stéréotypes racistes. Il fallait également démontrer que ce discours de haine portait en lui une exhortation à la discrimination, en d’autres termes à soutenir que ceux-ci étaient destinés à susciter chez le public un sentiment de rejet, voire de haine envers la personne et les œuvres d’Aya Nakamura en raison de son origine.
À l’audience, les rares prévenu·es présent·es ont fait le choix du silence. N’y a-t-il pas là une contradiction flagrante avec leur geste, qui a eu lieu en public et qui avait pour objectif d’être diffusé largement pour créer une hostilité envers l’artiste ? Cette contradiction ne révèle-t-elle pas également l’ambiguïté de leur revendication à provoquer un débat ? Ou bien leur conception du débat est-elle si radicalement différente qu’ils n’acceptent le débat que lorsqu’ils sont les seuls à s’exprimer ? Ce qui, convenons-en, est effectivement plus simple…
Il ne faut pas se tromper, ce procès permet de mettre en lumière le projet politique de ces individus et groupes qui œuvrent pour normaliser le discours raciste et discriminatoire porté par l’extrême droite. Doit-on d’ailleurs rappeler que de la parole à l’acte il n’y a souvent qu’un pas ? Ibrahim Ali, jeune Français d’origine comorienne a été tué en 1995 à Marseille par un colleur d’affiches du Front national. Le 31 mai 2025, Hichem Miraoui, ressortissant tunisien, est tué par balle par un individu souhaitant l’arrivée du Rassemblement national au pouvoir³.
À cet égard, une possibilité juridique existe pour contrer le projet politique de l’extrême droite et qui mérite réflexion : la peine d’inéligibilité.
Si elle a fait grand bruit concernant Marine Lepen, cette peine complémentaire peut aussi être prononcée dans la répression des discours de haine⁴.
Certains veulent porter le racisme comme projet politique, il est donc dans l’ordre des choses de les en empêcher par une simple application de la loi, expression de la volonté générale.
Et s’il n’appartient pas à l’avocat·e de requérir une peine, il lui incombe en revanche de défendre son client. Les avocat·es engagé·es contre les discours de haine déploient alors tous leurs efforts pour honorer cette mission.
Le 17 septembre 2025, la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris a rendu sa décision. Elle a reconnu coupables et condamné à une peine d’amende 10 des 13 prévenus pour l’infraction d’injure publique à caractère raciste, et non pour incitation à la haine. Cette requalification avait été plaidée par les avocats des associations parties civiles.
Le tribunal a jugé que les militants d’extrême droite avaient exprimé un profond mépris envers la chanteuse en raison de ses origines, mais aussi que leur action véhiculait un message particulièrement dégradant à l’encontre de l’ensemble des personnes issues de « l’immigration subsaharienne ». La 17e chambre a également précisé que ces propos racistes constituaient un abus de la liberté d’expression et ne pouvaient être tenus sous couvert de critique à dimension politique.
Notes et références
1. CE, Juge des référés, formation collégiale, 03/05/2021, 451743, Inédit au recueil Lebon
2. Au procès de la banderole hostile à Aya Nakamura, les identitaires assument, mais en silence. Le Monde. 5 juin 2025.
3. Meurtre d’Hichem à Puget-sur-Argens : le profil du suspect met en lumière l’ambiguïté des discours du RN. La Provence, 15 juin 2025.
4. Article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse