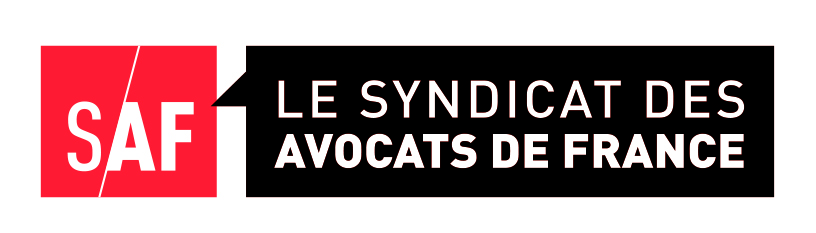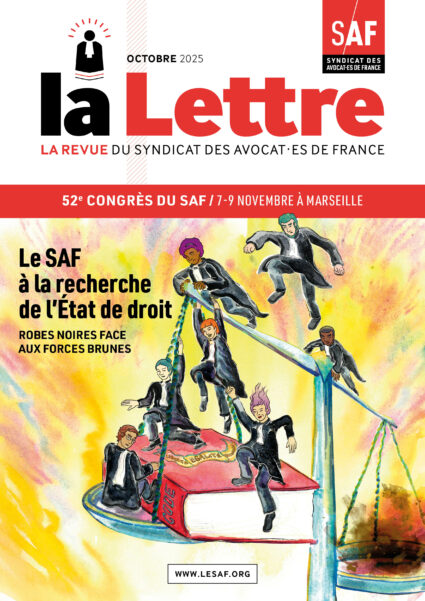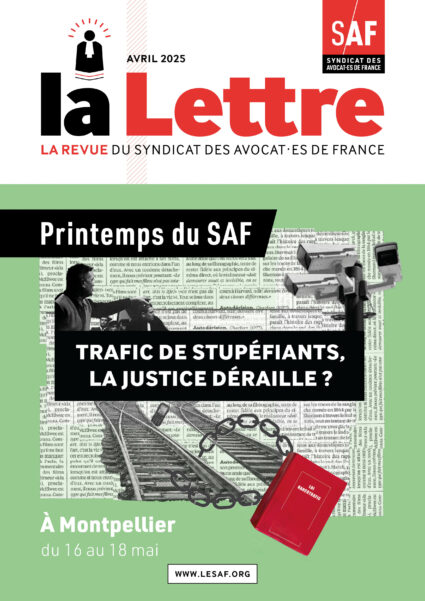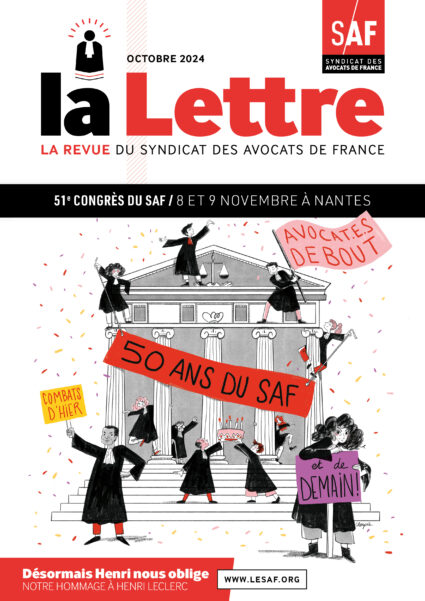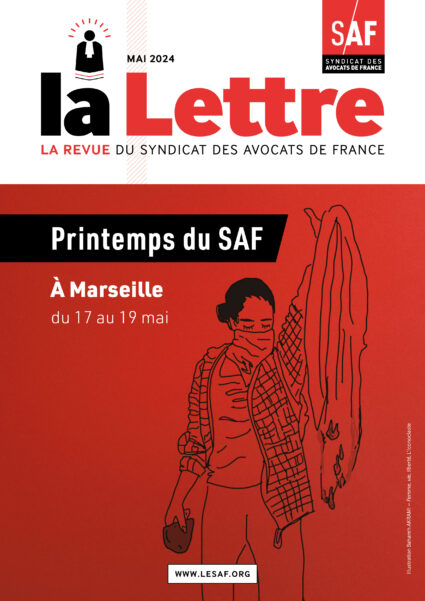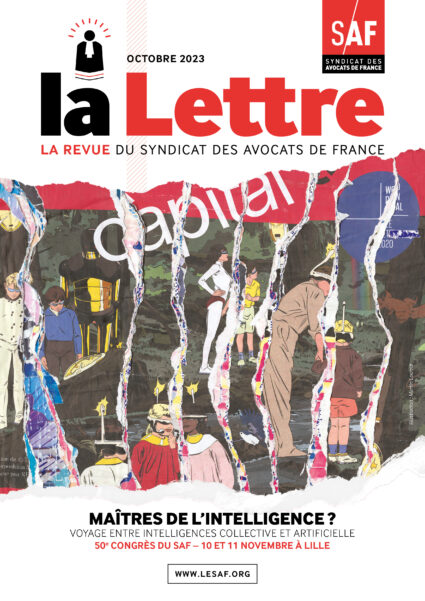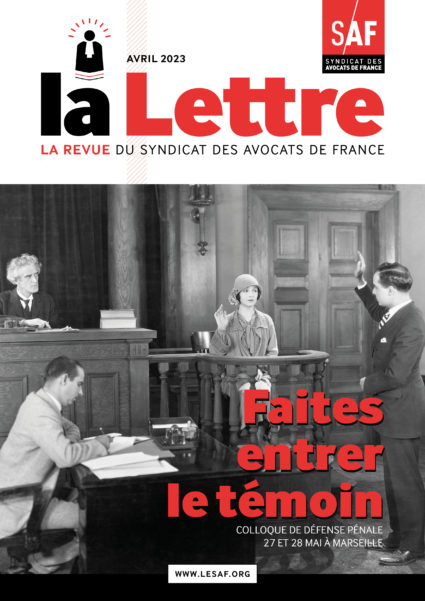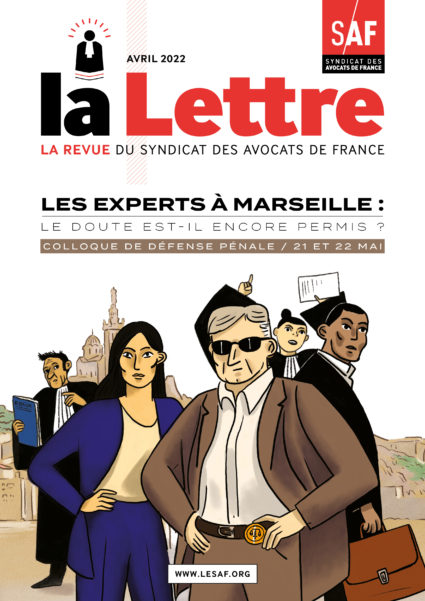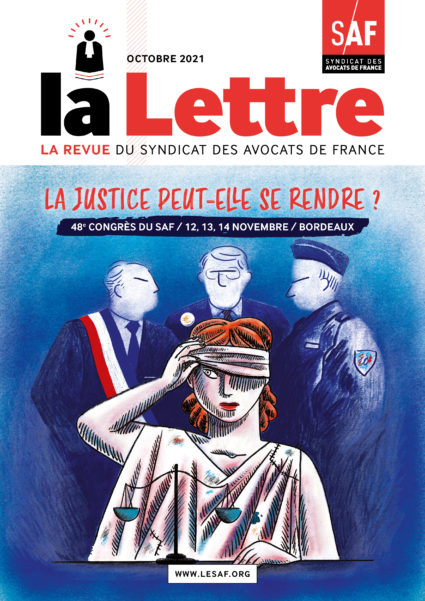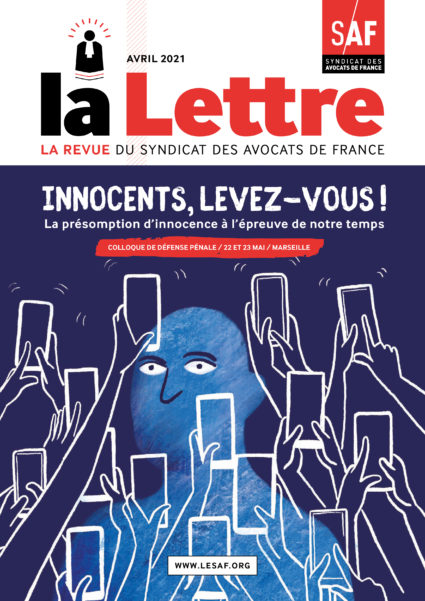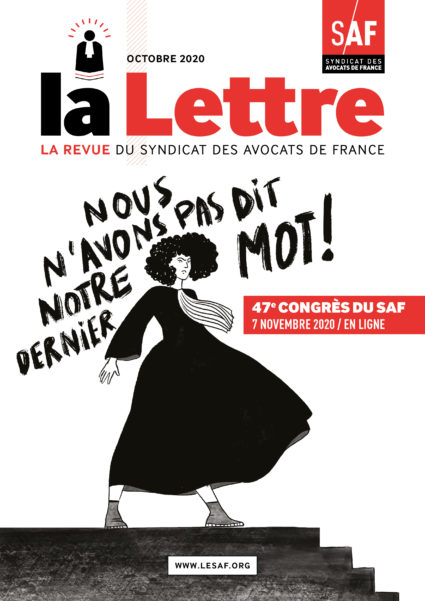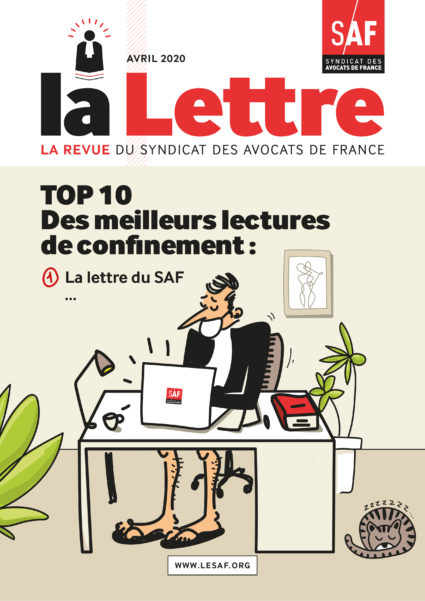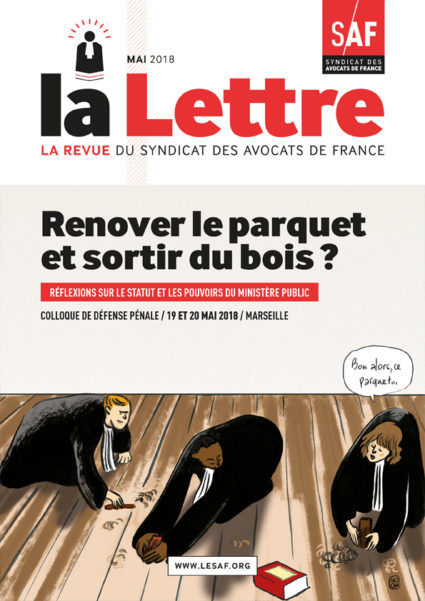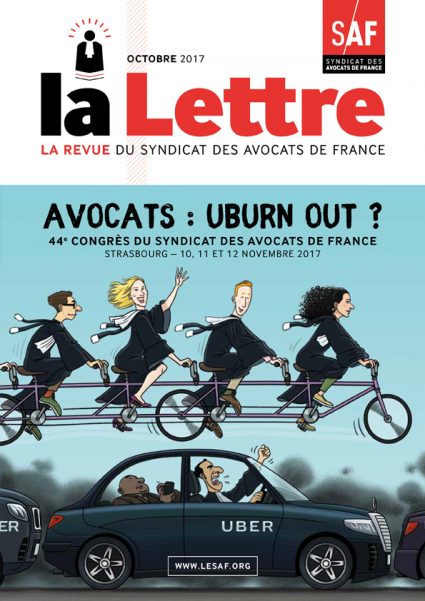Un décloisonnement des réflexions nécessaire à la convergence des luttes, sur le terrain et dans les prétoires ?
Convergence contre la répression
Il est relativement aisé d’envisager une convergence des luttes, lorsque l’on aborde le sujet sous l’angle de la répression croissante subie par les militant·es en tout genre, lanceur·ses d’alertes, syndicalistes, manifestant·es (en amont des manifestations avec les procédures baillons, pendant et en aval avec les poursuites judiciaires) ou militant·es écologiques (arrestations violentes allant parfois jusqu’à la mort1, tentatives de dissolution d’associations…).
La diversité des formes et des cibles de cette répression généralisée montre clairement que la résistance au système capitaliste libéral gène. Elle gène les puissant·es, elle gène les gouvernant·es.
La convergence des luttes peut alors se traduire par des réactions sur le terrain sous forme de mobilisation (toucher à un·e militant·e c’est toucher à tous·tes les militant·es), ou par des actions de communication concertées (tribunes inter-organisationnelles, organisation de meetings et autres événements).
Elle peut donner lieu à des actions communes devant les tribunaux (par exemple avec des recours engagés en commun par plusieurs organisations syndicales et organisations de lutte pour les droits fondamentaux contre les interdictions de manifester, la mise en place de fichiers etc.).
Convergence dans l’action
Mais en amont de la répression, au stade de la construction des actions militantes, la convergence des luttes est moins évidente, parce que même si les intérêts et objectifs sont communs à long terme, ils sont souvent moins apparents à court terme.
Pourtant, cette convergence parait indispensable pour donner plus de chance de succès aux combats menés, voire pour éviter qu’ils se nuisent les uns aux autres. Et pour y parvenir, le seul moyen semble être le décloisonnement des réflexions par l’échange, la recherche d’objectifs communs et ce, avant l’engagement d’actions qu’elles soient sur le terrain ou devant les tribunaux.
C’est particulièrement parlant pour ce qui concerne l’emploi et l’environnement.
Ainsi comment concilier les actions visant à démanteler une activité polluante avec le maintien des salariés concernés dans leur emploi et avec les besoins énergétiques et alimentaires ? Comment éviter qu’une activité polluante soit arrêtée et les salarié·es licencié·es parfois au prétexte d’une apparence de volonté écologique pour être en réalité transférée plus loin (entraînant du « dumping » écologique et social) ?
 Pour permettre d’atteindre le fameux slogan « on ne veut pas choisir entre la fin du monde et la fin du mois » et permettre – y compris aux militant·es – pour leurs combats, de continuer par exemple à utiliser les réseaux sociaux (lesquels demandent notamment beaucoup d’eau et d’énergie) quel pourrait être l’objectif commun des militant·es syndicaux·ales et écologistes ?
Pour permettre d’atteindre le fameux slogan « on ne veut pas choisir entre la fin du monde et la fin du mois » et permettre – y compris aux militant·es – pour leurs combats, de continuer par exemple à utiliser les réseaux sociaux (lesquels demandent notamment beaucoup d’eau et d’énergie) quel pourrait être l’objectif commun des militant·es syndicaux·ales et écologistes ?
Une réponse serait peut-être d’agir ensemble pour essayer de contraindre l’État et les groupes industriels à anticiper et à investir massivement dans la recherche, par exemple pour remplacer progressivement, sur des sites industriels déjà existants et avec les salariés en poste, la production d’énergie fossile par d’autres moyens de produire de l’énergie, l’engrais, les matériaux toxiques ou les matériaux de construction etc., par d’autres matériaux. De telles démarches pourraient être combinées avec d’autres visant à organiser en parallèle, autant que possible, une forme de décroissance des besoins.
La convergence des luttes peut là encore être menée sur le terrain, via des actions élaborées entre organisations syndicales et écologiques, en prenant soin de ne pas mettre en cause l’outil, la qualité, les conditions de travail, ou l’emploi.
Devant les tribunaux aussi, les réflexions communes sont utiles : des notions de droit du travail peuvent être mobilisées, comme la possibilité pour les représentant·es du personnel de proposer des projets alternatifs2, l’obligation de négocier sur « la mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique »3 et naturellement l’obligation de prévention de la santé et de la sécurité des travailleur·euses4, mais ces notions gagneraient à être combinées avec des notions de droit de l’environnement, comme le droit constitutionnel des générations futures et des autres peuples à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé5.
Peut-être qu’en tant qu’avocat·es, nous pourrions participer à ce décloisonnement en suscitant des rencontres à l’occasion de nos dossiers (entre confrères et consœurs chargé·es d’accompagner les associations écologiques et les organisations syndicales, puis avec nos clients respectifs) ? Peut-être pourrions-nous davantage encore mettre en commun nos décisions (via notamment les commissions sociales et environnementales du SAF) et organiser encore plus de formations communes pour découvrir d’autres notions et construire ensemble des actions qui puissent être utiles à tous ces combats ?
Naturellement, le décloisonnement des réflexions, nécessaire à la convergence des luttes, ne se limite pas aux sujets de l’environnement et de l’emploi. Il existe déjà par exemple dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, contre l’exclusion des personnes en situation de handicap ou contre le racisme (par exemple en mettant en commun les jurisprudences liées à la discrimination, mais aussi en recherchant comment concilier la défense des victimes avec les droits de la défense et la protection de la présomption d’innocence).
Favoriser par tous les moyens le décloisonnement de nos réflexions, c’est non seulement un moyen de mieux nous comprendre et donc mieux nous respecter les un·es et les autres, mais c’est aussi un moyen de gagner des luttes et de faire progresser des causes auxquelles nous croyons. Favoriser le décloisonnement de nos réflexions, c’est non seulement un moyen de mieux nous comprendre et donc mieux nous respecter les un·es et les autres, mais c’est aussi un moyen de gagner des luttes dont même les opposants initiaux pourraient apprécier les conséquences vertueuses et de faire progresser des causes auxquelles nous croyons. Cela doit donc permettre l’émergence d’idées pour construire une alternative radicale à ce que nous proposent les gouvernants actuels et l’extrême droite et ainsi nous aider à garder de l’espoir.