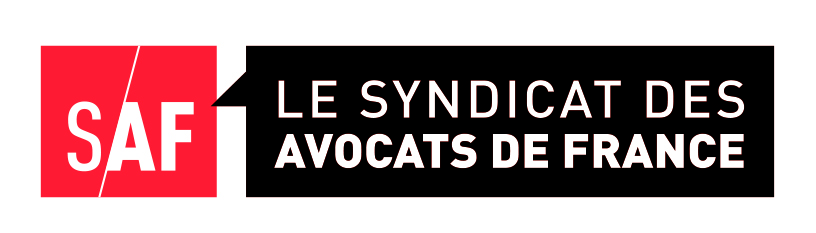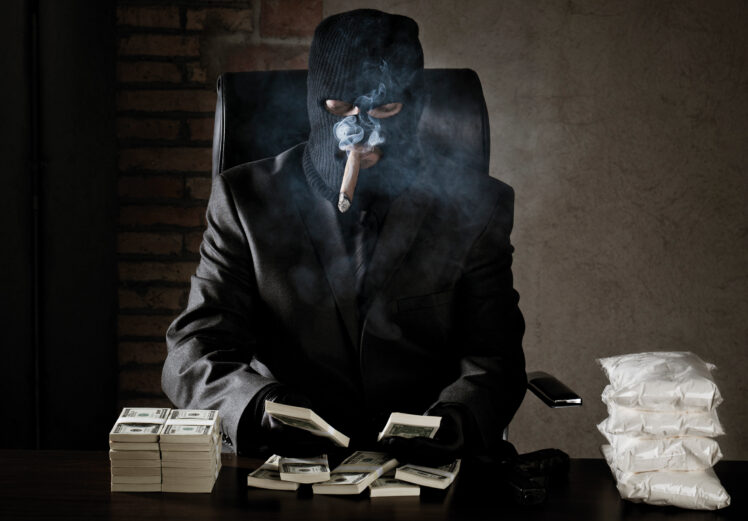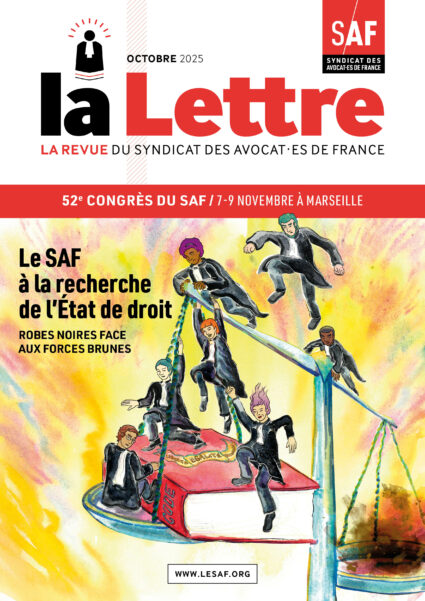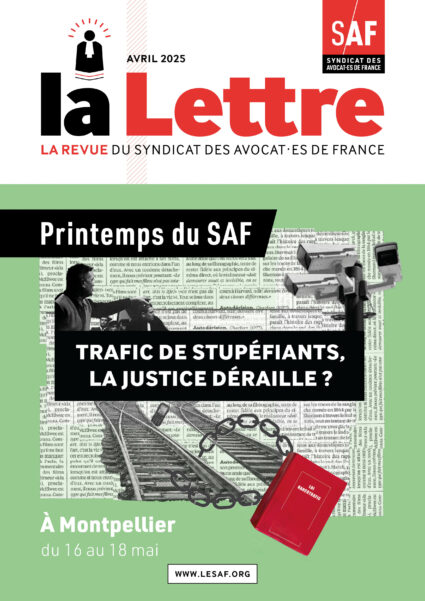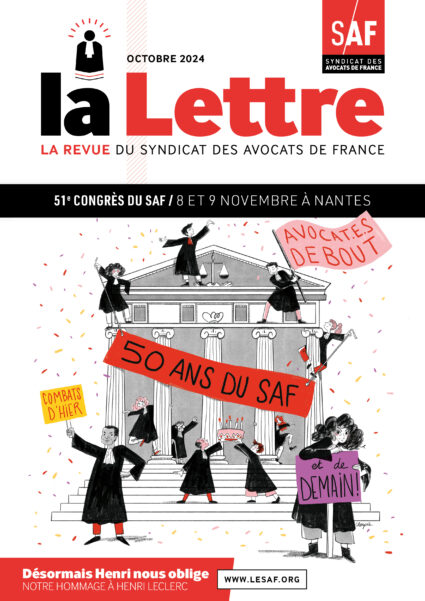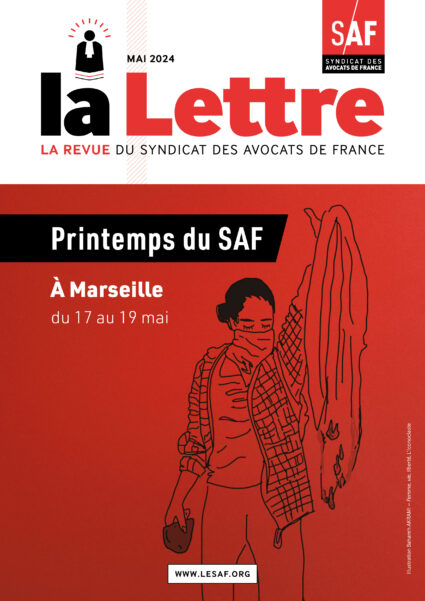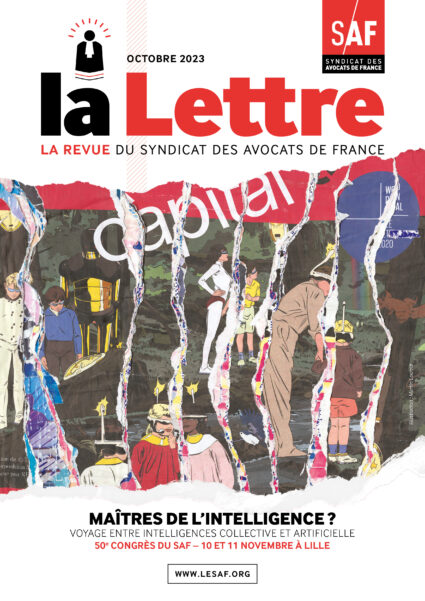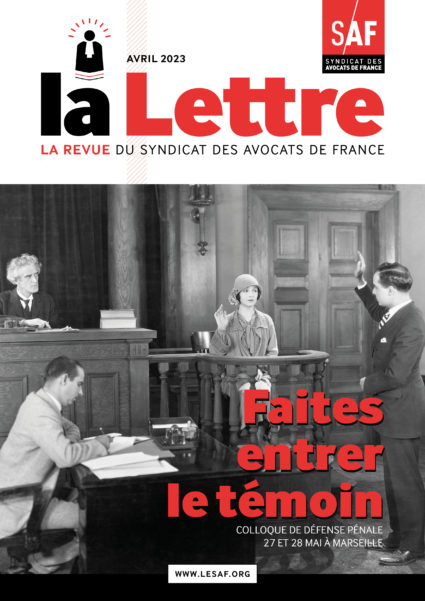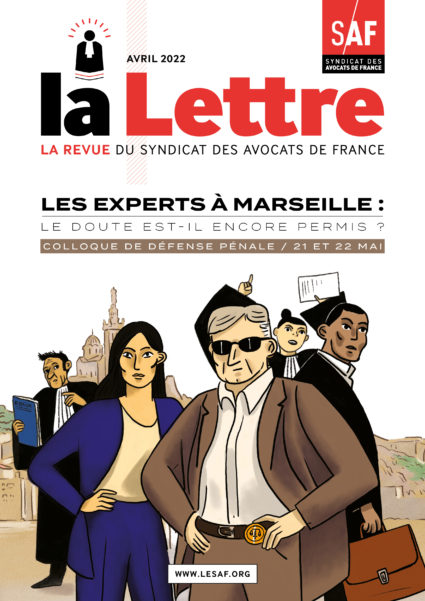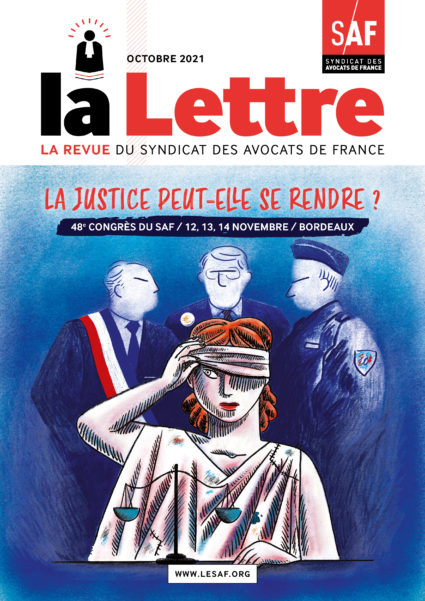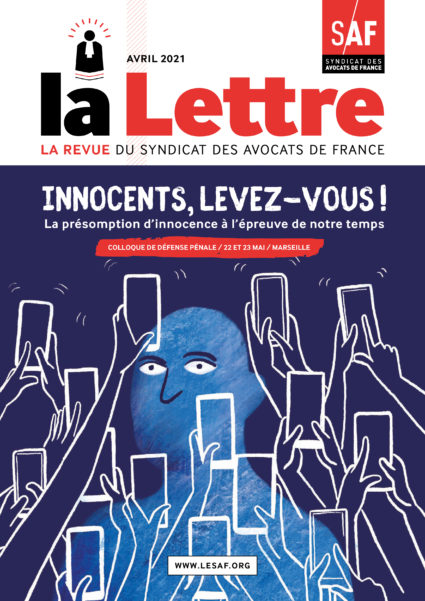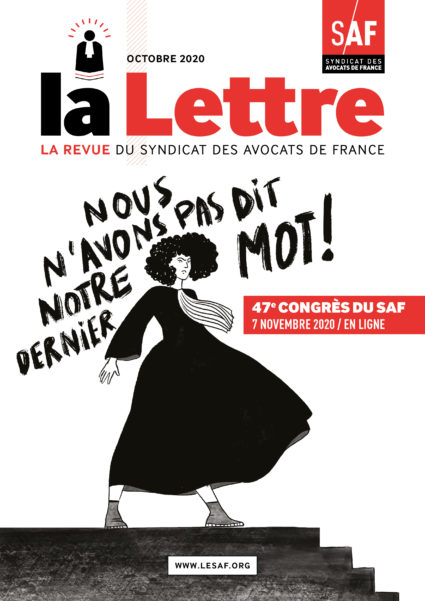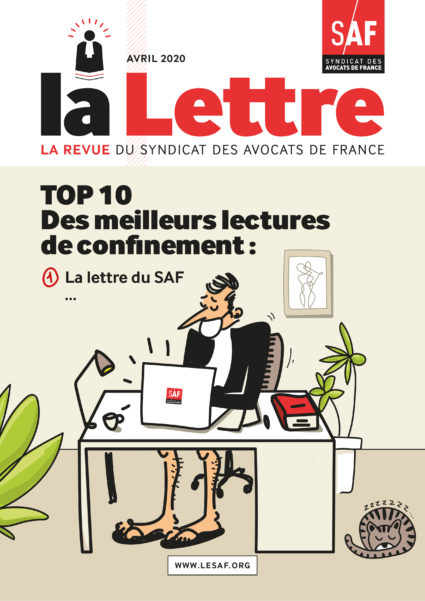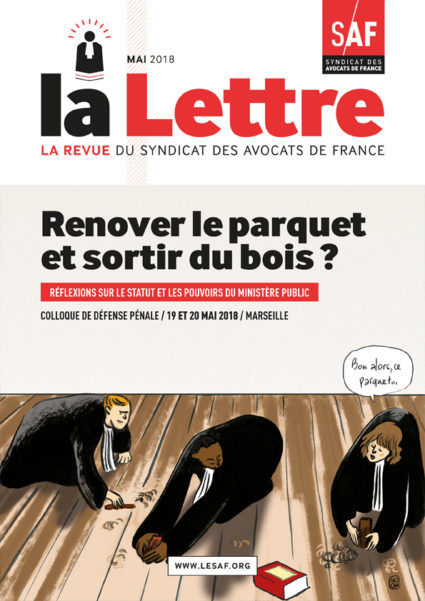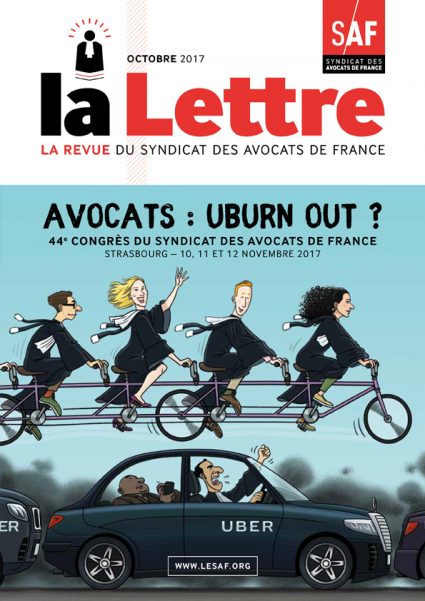Depuis l’automne 2024, Bruno Retailleau, rejoint ensuite par Gérald Darmanin, a décidé de faire de la lutte contre le trafic de stupéfiants un thème central, à grands coups d’hyperboles sécuritaires. Une surenchère qui donne lieu à des glissements sémantiques lourds de sens.
Le surgissement tonitruant du préfixe « narco » dans le débat public a de quoi déconcerter. Il a simplement fallu que le ministre de l’Intérieur décide d’en faire un élément de langage pour que, du jour au lendemain, celui-ci soit adopté par tout le champ médiatique. Soudainement, il n’a plus semblé possible de faire une phrase sans l’accoler à un mot quelconque, donnant lieu à un concours de néologismes confinant parfois au ridicule : narcoville, narchomicides, narcoracailles…
Il n’est donc plus question de « trafic de stupéfiants », mais de « narcotrafic », dans lequel les personnes impliquées, du guetteur jusqu’au grossiste, sont toutes affublées du qualificatif « narcos ». La référence aux cartels colombiens ou mexicains, et aux séries Netflix qui leur sont consacrées, prêterait à sourire si elle n’avait pas vocation à renvoyer à une imagerie inquiétante, destinée à forger les esprits, à les formater. L’étymologie de ce nouveau discours n’est d’ailleurs jamais discutée.
L’évocation de l’Amérique latine est parfois encore plus explicite. À l’automne 2024, Bruno Retailleau reprenait à son compte le terme « mexicanisation » pour évoquer les règlements de compte sur fond de trafic de drogue, notamment à Marseille. Que les 24 décès comptabilisés en 2024 (49 en 2023) dans cette ville française constituent autant de drames, c’est une évidence. Mais peut-on comparer à la situation au Mexique, où la guerre des cartels a entraîné 450 000 morts et 100 000 disparus depuis 2006 ? En novembre 2024, au Mexique, on se félicitait d’une baisse du nombre d’homicides, avec « seulement » 2 234 personnes tuées ce mois-là. Rapportés à la population française, cela revient à 1 200 homicides chaque mois. À ce niveau de décalage, la comparaison relève de l’indécence.
Cette bascule du discours politique et médiatique est d’autant plus saisissante qu’elle est corrélée à une évolution assumée du discours de certains magistrats. Ainsi, au printemps 2024, devant la commission d’enquête sénatoriale, une juge d’instruction expliquait mener une « guerre » qu’elle craignait de perdre. Le mot « guerre » était d’ailleurs entendu des dizaines de fois durant ces mois d’auditions sénatoriales. Le procureur de la République de Marseille suggérait pour sa part que l’on parle de « narcoterrorisme » : terrorisme et narcotrafic, jonction de deux épouvantails, fusion de deux figures de l’ennemi intérieur. La boucle est bouclée.
Tous contre le nouvel ennemi intérieur
La désignation d’un ennemi intérieur a plusieurs fonctions. D’abord, elle légitime la pensée et l’action de celui qui opère cette désignation, ce dernier faisant ainsi la preuve de sa « lucidité » face à une menace rampante que d’autres n’ont pas voulu voir, de son « courage » en se plaçant aux avant-postes de cette guerre qu’il entend mener avec la plus grande fermeté, cela va de soi.
La guerre contre l’ennemi intérieur crée aussi une ligne de partage, entre alliés, d’une part, et adversaires ou leurs complices, d’autre part. De ce fait, la figure de l’ennemi intérieur force à solidariser tous ceux qui, à juste titre, ne souhaitent pas se voir suspecter de mansuétude à l’égard des « narcotrafiquants », les sommant d’accepter un discours unique, ainsi que son contenu concret. De ce fait, l’offensive rhétorique engagée depuis l’automne 2024 a pour objectif de créer les conditions d’acceptabilité de mesures attentatoires aux droits de ceux qui sont présentés comme n’étant plus dignes d’en disposer, du moins d’en disposer autant.
Sur le plan politique, l’expression la plus spectaculaire de ce phénomène a été l’adoption au Sénat, début février 2025, du texte « proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic » soutenu par le duo Retailleau-Darmanin, par l’ensemble des groupes, droite et gauche confondues. Qu’une telle unanimité ait pu se réaliser autour d’un texte qui constitue pourtant un recul très important de l’État de droit donne la mesure de la puissance du narratif de la « guerre contre le narcotrafic ».
Reconquérir des territoires
Si le glissement sémantique vers le « narco-ennemi de l’intérieur » a rencontré un tel écho, cela tient peut-être au fait qu’il exprime un impensé, ou du moins un non-dit sans lien direct avec le trafic de stupéfiants, qui sous-tend pourtant un certain nombre d’actions politiques déjà engagées depuis plusieurs années. C’est le cas, notamment, des opérations « place nette », engagées à partir de la fin de l’année 2023, et consistant en un déploiement massif de forces de police concentrées dans certains quartiers.
La critique de l’efficacité judiciaire de telles opérations est juste, mais inutile, car ce n’est précisément pas sur ce plan qu’elles ont été pensées, ces actions s’apparentant beaucoup plus à des opérations de contre-terrorisme. En effet, il est difficile de ne pas voir dans ces opérations « place nette » des similitudes avec les opérations de contrôle de territoire effectuées par l’armée française lors d’opérations extérieures ces dernières années, ratissant des villages en Afghanistan ou dans le nord du Mali. Ou encore, le lien généalogique est plus ancien mais peut-être plus sûr, avec les descentes de police dans les foyers de travailleurs algériens dans les années 50 et 60, opérations visant à terroriser ces derniers, au prétexte de traquer les militants du FLN – l’ennemi intérieur de l’époque.
Les opérations « place nette » étaient déjà l’expression concrète d’une vision dont le contenu politique émerge désormais pleinement.
C’est ainsi que, quelques mois après une nouvelle vague d’opérations « place nette XXL », Bruno Retailleau évoquait « des enclaves, des mini-États, des narco-enclaves en train de se constituer ». La guerre contre l’ennemi intérieur est donc aussi une guerre pour la reconquête et le contrôle de territoires, dans une représentation qui n’a plus grand-chose à voir avec l’action judiciaire, et s’apparente en fait à une guerre civile larvée.
Et c’est là que le contenu social et politique de cette guerre se dévoile. Les territoires visés, ce sont bien sûr les quartiers populaires, et en particulier ceux qui sont les plus délaissés par les pouvoirs publics ces dernières décennies, et dont les populations doivent être mieux contrôlées. La proposition de loi contre le narcotrafic généralise d’ailleurs la possibilité d’expulser des familles entières en cas de simple « trouble » causé par l’un de ses membres, permettant ainsi une gestion arbitraire des locataires, placés dans l’angoisse constante d’être chassés de leur domicile.
Après plus d’une décennie au cours de laquelle le terrorisme a été utilisé pour justifier nombre de reculs démocratiques, la figure du « narcotrafiquant » semble désormais devoir prendre le relais. Plus que jamais, la résistance face à ce mouvement passera par la déconstruction du discours qui le sous-tend.