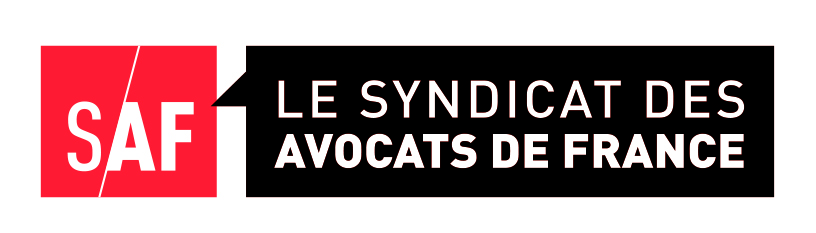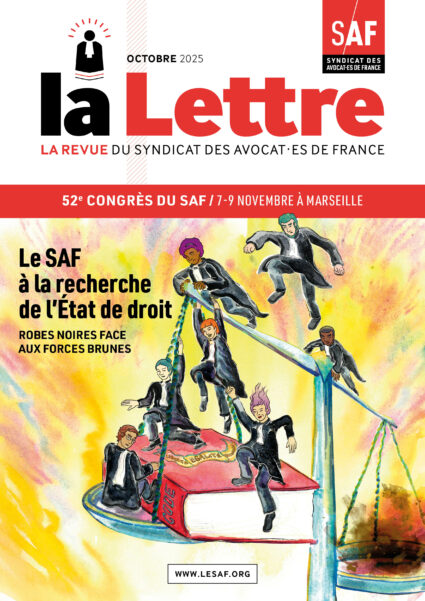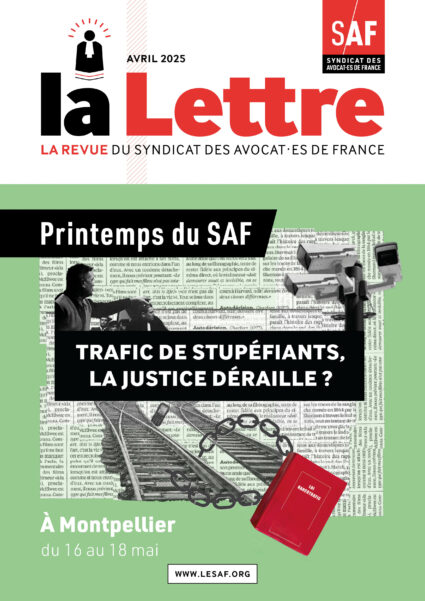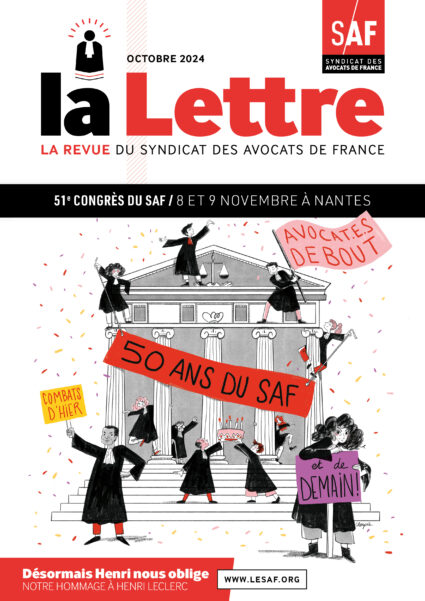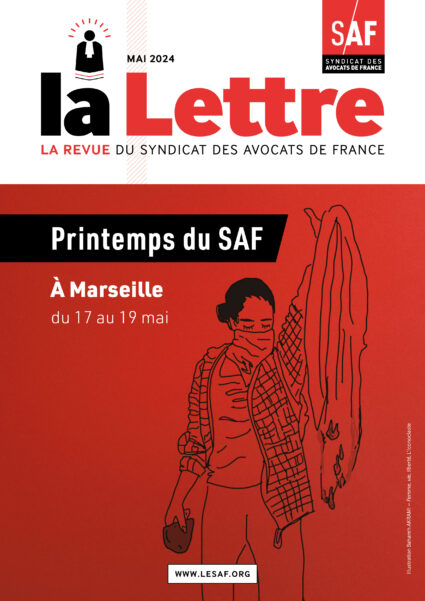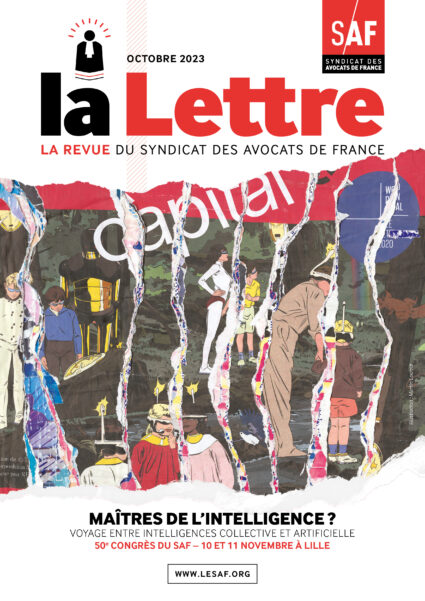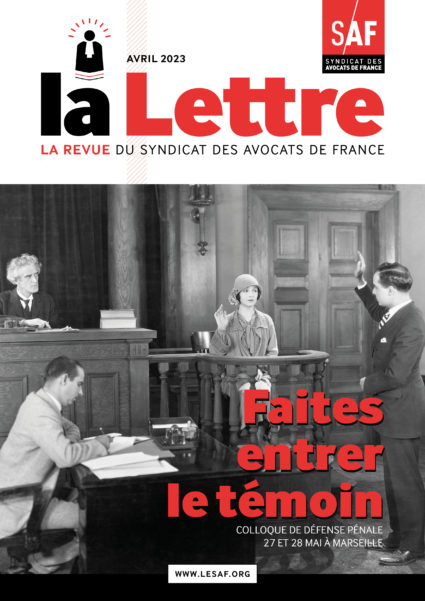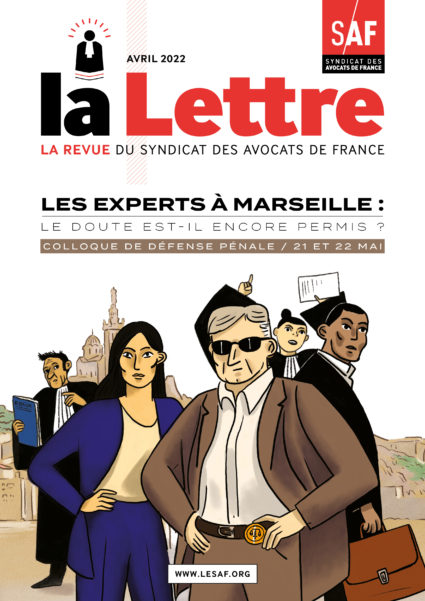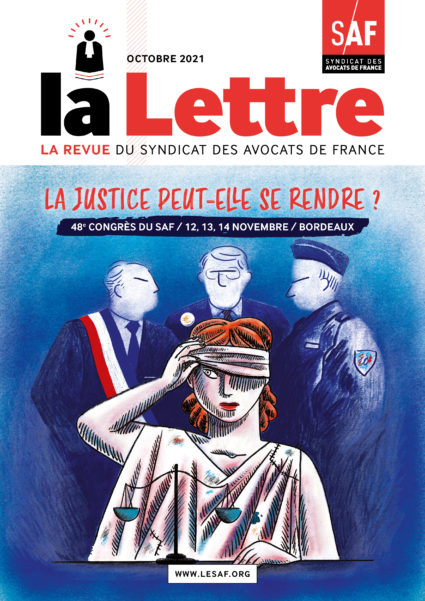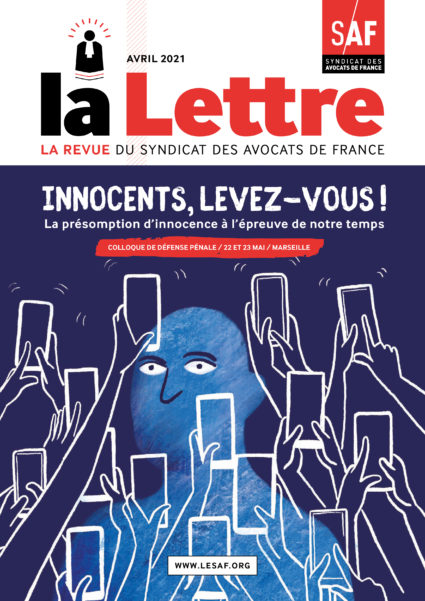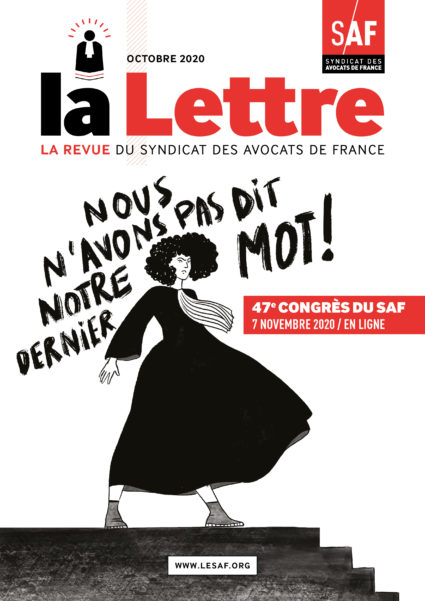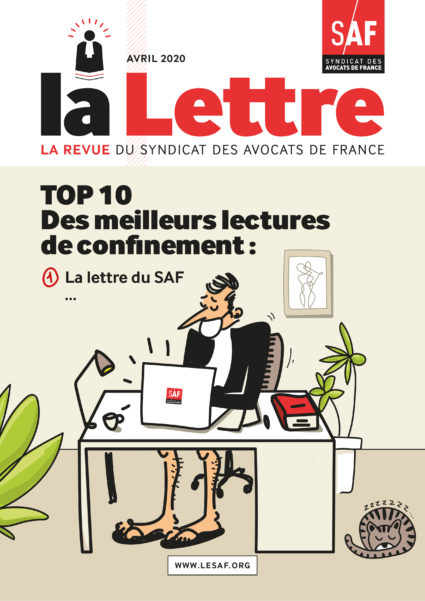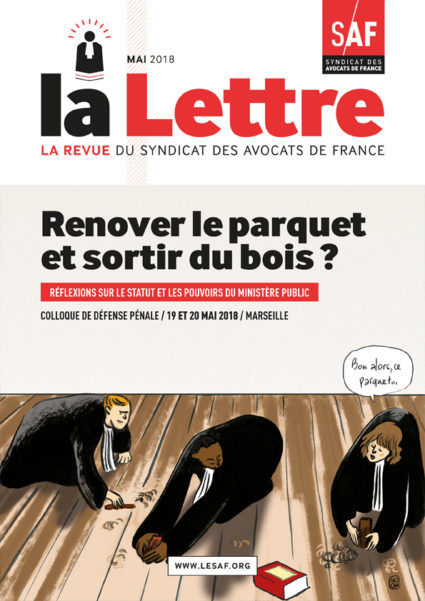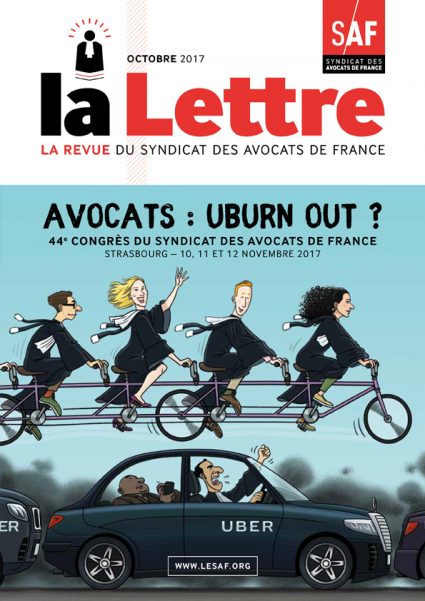La société civile était tellement préoccupée par l’effondrement de la biodiversité, le dérèglement climatique et les pollutions chimiques, qu’elle réussit, à force de luttes sur les territoires et dans les prétoires, à les faire entrer dans l’agenda médiatique et politique.
Certain·es magistrat·es, osèrent même lier les droits humains avec les droits de l’environnement par cette phrase si inspirante : le devoir de protection va de pair avec l’impératif de prendre soin des fondements naturels de la vie, d’une manière qui permette de les léguer aux générations futures dans un état qui laisse à ces dernières un choix autre que celui de l’austérité radicale si elles veulent continuer à préserver ces fondements ».
À portée de main : le droit au respect des générations futures et des autres peuples, avec une approche transgénérationnelle (générations futures) des risques à appréhender tout de suite, et une approche transfrontière (les autres peuples) des efforts à mener en coopération.
Nous parlions du concept « One Health » : une santé des humains, de l’ensemble du vivant, puisque toutes et tous respirent le même air, boivent la même eau, se nourrissent dans la même terre et mère. Avec l’espoir d’une vision englobant enfin la complexité et la nuance.

L’année 2024 aura vu la consécration par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), de la recevabilité d’une association environnementale « Verein Klimaseniorinnen » contre la Suisse pour inaction climatique, au regard d’une violation des articles 6 et 8 de la Convention.
Oui, c’est symbolique, oui les conditions de recevabilité des associations de protection de l’environnement demeurent bien drastiques, oui les droits humains même avec l’interprétation dynamique de la Cour de Strasbourg, restent grandement inadaptés aux pollutions diffuses, de masses, tout comme le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 14 février 2025 a rejeté tous les moyens pour tenter d’élever au rang constitutionnel la protection de l’animal.
À nous, avocat·es, de persévérer et de trouver les solutions juridiques, qui hier encore étaient jugés très délicates, comme un référé liberté obtenue au secours du lagopède alpin .
On ne peut que se féliciter par ailleurs des Pôles Régionaux Environnement au sein des Tribunaux judiciaires qui se sont développés, en compétence, en volume, en soutien, ou de la création d’une chambre d’appel ad hoc à Paris pour les contentieux climatiques.
Et puis le backlash. Des mots que l’on croyait enfouis indéfiniment comme à Stocamine ou Bure – quelle blague – remontent à la surface : éco-terrorisme, la lampe à huile, « l’OFB c’est stop, ils sont allés trop loin », l’écologie « punitive », l’écologie « sectaire », voire « totalitaire ». Je suis devenu khmer vert paraît-il.
Des voix s’élèvent, même au sein de notre profession, même au sein de notre syndicat, pour considérer qu’être avocat·e « militant·e » pour la protection de l’environnement, ce serait se rabaisser, ce serait prendre parti.
Mais non, contrairement à ce que certain·es osent plaider, la défense de la qualité de l’eau, ce n’est pas une opinion, ce n’est pas protection de l’environnement versus souveraineté alimentaire. C’est notre héritage, notre patrimoine, la condition même de la présence de la vie sur terre. Pulvériser du produit phytosanitaire au doux nom commercial de Bueno le long d’un cours d’eau, ce n’est pas bueno du tout.
Alors, on récapitule les derniers mois qui sentent le backlash de lois et de décisions qui, sous couvert de modernité et d’adaptation, de simplification et de guichets uniques, sont une longue et méthodique régression, nous contraignant à rejouer la dramaturgie de Sisyphes en robe noire.
Patience et urgence, dur dilemme éternel, mais tout particulièrement « quand la maison brûle », dans l’attente de tant de décisions sur le fond qui tardent à intervenir, consacrant le fait accompli, donc la force et non le droit : la victoire au goût amer, mais victoire tout de même ! de l’A69, non définitive, acte tant l’obstination des services de l’État inféodés aux concessionnaires privés, que de l’inadaptation des procédures pour avoir le temps d’appréhender la complexité de tels dossiers et obtenir des réponses rapides pour les opérateurs privés et les vivants du territoire impacté.
J’espère me tromper quand je subodore des modifications législatives ou réglementaires à venir, qui ne retiendront que le second pan de la problématique : vite ! vite ! Allons plus vite !
Et si on supprimait le double degré de juridiction ? Et si raccourcissait à 10 mois l’instruction d’un recours contentieux ? Et si on passait l’ensemble des élevages bovins, et une bonne partie des élevages industriels de volailles et de porcins sous le seuil de l’évaluation environnementale systématique, mais au cas par cas ? En s’arrangeant, discrètement et sans recours possible, d’en dispenser .
Ou, plus vicieux : et si on attribuait une compétence de premier et dernier ressort au seul tribunal administratif de Paris en matière d’ouvrages hydrauliques agricoles (plus connus sous le nom de méga bassines), histoire de rapprocher le justiciable ?
Et si en plus, rien que pour rire, on réduisait le délai de recours des tiers contre les décisions en matière ICPE de 4 à 2 mois (qui était encore d’un an il n’y a pas si longtemps ? Et si en plus on cassait les pieds de tout le monde en faisant comme en urbanisme en imposant de notifier le recours contre une autorisation environnementale à l’auteur de la décision et à son bénéficiaire, à peine d’irrecevabilité ou en cristallisant les moyens ? Et si on noyait le commissaire enquêteur au sein d’une consultation publique remodelée, électronique, mais au nom d’une participation du public dès le début du projet ?
Et puis, il y a le ZAN qui se fait joyeusement détricoter par le Sénat, si ce n’est enterré , le travail du lobbying nucléaire pour faire démarrer des travaux avant autorisation finale (pour l’EPR2 et en cours pour Cigéo) : « drill, baby, drill » (Trump) « plug, baby, plug » (Macron) .
Et enfin, last but not least, la loi d’orientation agricole du 21 février 2025… les règles sur les pesticides assouplies, les atteintes non intentionnelles dépénalisées, avec des sanctions administratives minimes et priorisées par rapport aux poursuites pénales, on réserve la qualification de délit aux seuls actes intentionnels, avec une présomption d’absence d’intentionnalité en cas de respect d’obligations légales ou d’autorisations administratives…
Et une modification de l’article 410-1 du Code Pénal qui introduit l’agriculture au sein des intérêts fondamentaux de la nation : et donc les actes de sabotage de canalisations d’ouvrages de méga-bassine – ou de désarmement – deviendraient ainsi des infractions criminelles… Si le Conseil Constitutionnel laisse passer cela.
Le grand remplacement du droit par la force c’est maintenant, étant rappelé que cette criminalisation des actions non-violentes qu’elle permettrait, a été soutenu jusqu’au bout par le gouvernement.
May the respect of Law be your force.