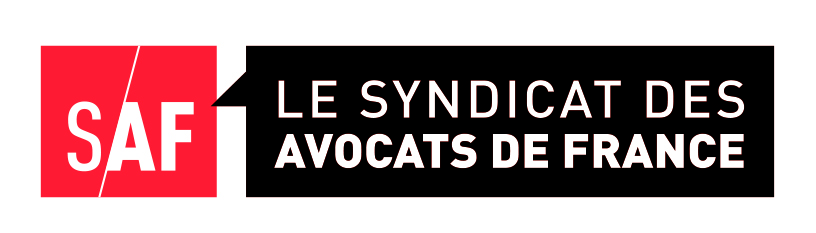Dans un contexte international de régression du droit à l’IVG, le gouvernement, porté par une opinion française largement favorable à inscrire le droit à l’IVG dans la constitution, a soumis au Parlement un projet de loi constitutionnelle « visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse ». Comme son intitulé ne l’indique pas, il propose d’ajouter à l’article 34 de la Constitution, c’est-à-dire au titre des compétences du « législateur », les termes suivants : « La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse » Ce projet, actuellement débattu au Parlement, déçoit une partie de la communauté juridique et des acteur.ices de terrain qui espéraient que le texte permettrait d’empêcher un recul du droit à l’avortement. Le SAF partage cette déception et s’inquiète même de la propension du texte à ouvrir la porte à un tel recul. 1. Il est dangereux de qualifier de « liberté » un droit fondamental tel que celui d’accès à l’avortement. Certes, le Conseil d’État est d’avis que droits et libertés ont le même sens au regard du droit constitutionnel. Mais force est de constater qu’il a été décidé de choisir ici liberté
Dernières actualités // Droit de la famille
Droit de la famille
Constitutionnalisation de l’IVG : Un leurre grossier
Droit de la famille
Révocation de l’arrêt Roe v. Wade : Urgence mondiale pour l’avortement
La décision de la Cour Suprême des États Unis sur le droit fédéral à l’avortement constitue un recul sans précédent du droit des femmes à disposer de leur corps. Elle témoigne du fait que rien n’est jamais acquis en matière de libertés individuelles. L’avortement constitue une nécessité sociale dont des millions de femmes risquent de se retrouver privées, au nom des convictions religieuses d’un petit nombre. Le sort des femmes états-uniennes n’est pas isolé : En Pologne, le tribunal constitutionnel a récemment rendu un arrêt rendant pratiquement impossible l’avortement tandis que le parlement vient de rejeter une proposition citoyenne pour libéraliser la loi sur l’IVG ; La Chine a récemment lancé un programme pilote de santé publique destiné à décourager les femmes de recourir à l’IVG ; Une vingtaine de pays dans le monde interdisent totalement l’avortement : Malte, Égypte, Sénégal, Nicaragua, Salvador, etc. En France, l’extrême droite a pu prendre des positions hostiles à l’avortement, les mouvements”pro-life” ont profité de la virulence des courants hostiles à l’égalité des droits entre les couples et la mise en œuvre de l’IVG demeure précaire (déserts médicaux, suppression de près de 130 centres d’IVG en 15 ans, refus des prises en charge tardives, manque de moyens donnés au
Droit de la famille
L’IFPA ou le mirage de la garantie du paiement des pensions alimentaires
En 2016, le législateur a mis en place une intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) en cas de violences conjugales, permettant à l’organisme versant des prestations familiales (CAF ou caisse de la MSA) de collecter la pension alimentaire auprès du parent débiteur pour la reverser à l’autre parent. Depuis le 1er mars 2022, ce système est devenu automatique même en l’absence d’impayés. Il s’impose pour toutes les pensions alimentaires « en numéraire » fixées par un jugement de divorce, sauf si les parents s’accordent à le refuser ou, qu’à titre exceptionnel, le juge l’estime inadaptée à la situation des parties. Toutefois en cas de violences conjugales ou familiales l’IFPA est obligatoire. Présentée à tort comme une garantie de paiement, cette intermédiation n’est en réalité adossée à aucun fonds de garantie : en cas d’impayé de la pension alimentaire par le débiteur, l’ARIPA (agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires) ne réglera pas la pension alimentaire. Comme avant, des mesures de recouvrement des pensions alimentaires seront nécessaires en cas de défaillance du débiteur. Le créancier continuera seulement de bénéficier, et uniquement s’il y est éligible, de l’Allocation de Soutien de Famille (ASF), plafonnée à 116 € par enfant. Sans résoudre le problème des
Droit de la famille
Décrets procédure civile et divorce : porte étroite devant le Conseil d'État
Monsieur le Vice-Président du Conseil d’Etat, Le 15 novembre dernier, le gouvernement a adressé aux avocats des projets de décrets concernant la procédure civile (NOR : JUSC1927307D) et le divorce (NOR : JUSC1927431D), transmis pour avis au Conseil d’Etat. Les organisations syndicales de magistrats les avaient reçus dix jours avant leur examen en comité technique des services judiciaires, ce qui ne laissait aucune place pour un travail sérieux. La Chancellerie demandait aux différentes professions d’organiser de toute urgence des formations sur la base de ces projets, la date d’entrée en vigueur étant prévue pour le 1er janvier 2020. Nous déplorons le peu de considération accordé à nos professions, acteurs de ces procédures, et le peu de cas de votre avis qu’entend ainsi faire le gouvernement. Ces projets supposeraient une analyse exhaustive pour pointer les difficultés potentielles, les risques de contentieux inutiles et les problèmes pratiques susceptibles de se poser. Malheureusement, le temps qui nous est imparti ne nous le permet pas. En outre, la rédaction de certaines parties du décret est pour le moins approximative, en témoigne le projet d’article 54 du code de procédure civile « lorsqu’elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresses
Droit de la famille
Projets décrets procédure civile et divorce : mépris et désinvolture
La chancellerie choisit de communiquer le 15 novembre 2019 à la profession d’avocat les projets de décrets de la Loi pour la réforme de la justice, lesquels modifient de manière majeure procédure civile et procédure de divorce, pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2020. De qui se moque-t-on ? Autant de désinvolture à l’égard des justiciables et de mépris pour les avocats qui les représentent et les défendent confirme l’indifférence du gouvernement à l’égard de l’œuvre de justice et de tous ceux qui y participent. Le SAF avait exprimé ses plus grandes réserves sur la rédaction confuse de la loi ainsi que ses finalités exclusives d´économies et de régulation des flux. Les décrets élaborés hors de toute concertation confirment la volonté d’une justice mécanique et désincarnée. Leurs contenus rendent d’ailleurs totalement illusoire une application en l’état actuel des projets proprement incompréhensibles. Modes de saisine quasi uniques (et donc payant) du tribunal judiciaire, ce nouvel hybride fourre-tout successeur du Tribunal de grande instance et du tribunal d’instance supprimés d’un trait de plume par le gouvernement, exécution provisoire de droit, juge unique sont autant de mesures qui portent une grave atteinte à la qualité de la production judiciaire. Les professionnels peinent
Droit de la famille
Le projet de loi bioéthique : Des avancées majeures mais une réforme mineure de la famille
La règle de droit n’est acceptable que si elle est le « pur produit d’une société et d’une culture en un temps et un espace donnés » : les avocat.es qui défendent celles et ceux qui font famille le savent bien. 25 ans après l’adoption de la première loi bioéthique, 6 ans après l’adoption du mariage pour tous et après 2 semaines de débats de grande qualité en commission spéciale, l’Assemblée nationale s’apprête à examiner le projet de loi relatif à la bioéthique. Ouvrir la procréation médicalement assistée à toutes les femmes était une promesse du candidat Macron, une fois élu, il a fait le choix politique d’intégrer cette question aux débats relatifs à la révision de la loi bioéthique. Ce choix n’est pas neutre. Bien sûr la possibilité pour toutes les femmes qu’elles soient seules, ou en couple, de recourir à la procréation médicalement assistée doit être saluée comme une réforme majeure car elle est une mesure d’égalité, en phase avec l’évolution de la société et des individus qui font famille. De même permettre aux enfants nés de dons d’avoir accès aux données non identifiantes de leur donneur est un bon compromis pour l’accès aux origines sans remettre en question l’accouchement sous
A. J. et accès au droit
Les giboulées de mars : Le Conseil constitutionnel censure les atteintes aux droits de la défense et aux libertés mais valide une vision de la justice purement gestionnaire.
Droit de la famille
DIVORCE SANS JUGE : UNE PRIVATISATION PROGRESSIVE DE LA JUSTICE
Le 18 mai prochain, l’Assemblée nationale sera appelée à se prononcer, dans le cadre de la réforme « Justice du 21° siècle » sur une nouvelle forme de divorce par consentement mutuel, sans juge. Si dans sa majorité, le monde judiciaire estime que ces nouvelles modalités de divorce par consentement mutuel seraient modernes, moins couteuses et plus rapides, elles portent en réalité tous les risques de cette justice du 21°siècle sans juge. Cette réforme envisage de privatiser le divorce : non content d’en doubler le coût par le recours obligatoire à deux avocats, elle supprime l’homologation judiciaire et impose au justiciable de payer un notaire pour obtenir une décision auparavant gratuite. Elle ne désengorgera pas non plus les tribunaux : le divorce par consentement mutuel qui ne représente que 40% des divorces aujourd’hui, mobilise très peu de jours de travail pour les magistrats. En revanche, un divorce pour lequel tous les contentieux n’ont pas été correctement traités reviendra inévitablement devant le juge. L’absence du contrôle d’un juge dans cette nouvelle forme de divorce par consentement mutuel pourrait ainsi être source de nombreux contentieux ultérieurs. En effet, et contrairement à ce que certains laissent penser, le contrôle actuel du juge demeure effectif et la comparution