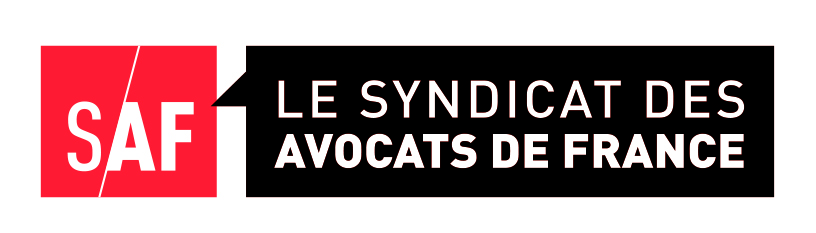Manifeste pour un service public plus humain et ouvert à ses administré.es Nous, associations de défense des droits humains et organisations agissant en solidarité avec les personnes, françaises ou étrangères, en situation de grande précarité, tirons la sonnette d’alarme quant à certains impacts négatifs de la dématérialisation des services publics sur l’accès aux droits. Le numérique occupe une place croissante pour l’accès au service public dans des domaines divers allant de la fiscalité à la protection sociale, en passant par les documents d’identité ou les titres de séjour. Or, si la dématérialisation des démarches administratives peut simplifier les démarches pour de nombreuses personnes, elle peut aussi être une source majeure d’entrave à l’accès aux droits pour d’autres. Ses effets délétères sont connus et très documentés par nos organisations, mais également par le Défenseur des droits dont le rapport “Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics” soulignait en janvier 2019 le “risque de recul de l’accès aux droits et d’exclusion pour nombre” d’usagers et usagères. C’est précisément, aujourd’hui, le constat fait sur le terrain par nos différentes organisations. Des administrations de plus en plus fermées au public La dématérialisation des services publics entraîne fréquemment, et plus que jamais depuis le début
Dernières actualités // A. J. et accès au droit
A. J. et accès au droit
MANIFESTE - Pour un service public plus humain et ouvert à ses administré.es
A. J. et accès au droit
Accès aux droits et aide juridictionnelle : nous ne voulons plus d'aumône
Élection des représentantes et représentants au Conseil national des barreaux 24 novembre 2020 La parole aux candidates et candidats : “La rétribution de l’aide juridictionnelle ne permet pas aux avocates et avocats de vivre dignement de leur travail. Elle met en péril les petits cabinets et fragilise l’accès au droit des plus précaires. Nous ne pouvons pas nous satisfaire d’avoir l’un des budgets les plus bas de l’Europe. La revalorisation nécessaire de l’unité de valeur ne sera pour autant pas suffisante. Au CNB, nous avons défendu et continuerons de défendre l’idée que la rétribution des missions à l’AJ ne doit pas s’arrêter au contentieux mais également aux frais annexes (comme les frais de déplacement) ainsi qu’aux consultations préalables. Nous défendons également le renforcement et l’extension des permanences dites « article 91 » aux secteurs du droit qui sont mal couverts (logement, consommation, tutelles…) : tout en garantissant le libre choix de l’avocat, ces permanences permettent d’organiser la défense, de faciliter nos conditions de travail et, in fine, de mieux garantir l’égalité des armes et l’accès aux droits. Enfin, nous nous opposerons au détournement des cliniques juridiques pour faire de l’accès au droit ou pire l’accès à la justice low cost. Les bénéficiaires de l’aide
A. J. et accès au droit
Contre la bunkérisation des palais de justice
Élection des représentantes et représentants au Conseil national des barreaux 24 novembre 2020 La parole aux candidates et candidats : “Au nom de la sécurité et depuis peu des contraintes sanitaires, nous assistons à la bunkerisation des palais de justice. Autrefois, espace ouvert au public, aux justiciables et aux professionnels, lieu de circulation permettant aux différents acteurs de la justice de se croiser, de se rencontrer, de se parler, de résoudre par l’échange des difficultés dans l’intérêt des justiciables ; aujourd’hui c’est le règne du contrôle et de la surveillance quand ce n’est pas celui de l’exclusion d’une partie de ceux qui y travaillent, les avocats, à l’image du palais de justice de Paris, high-tech aux pieds d’argile. Au-delà de la forme, c’est la fonctionnalité même qui est ségrégative : qu’il s’agisse de montrer patte blanche à tous les étages avec un badge – excluant les avocats qui ne sont pas du ressort – ou un petit interphone qu’il faut solliciter pour qu’on vienne nous ouvrir afin simplement de rencontrer greffier ou magistrat. Le CNB doit combattre cette vision sécuritaire, gestionnaire et technocratique de la Justice, et faire en- tendre raison aux pouvoirs publics. Nous nous battrons pour que les avocats soient systématique-
A. J. et accès au droit
Budget de l’aide juridictionnelle dans la loi de finances 2021: nous sommes toujours loin du compte
Le rapport PERBEN transmis le 26 août 2020 au garde des Sceaux reconnaît ouvertement que la prise en charge par l’avocat d’un dossier au titre de l’aide juridictionnelle se fait A PERTE. Ce rapport, déposé à la demande du gouvernement, préconisait une augmentation de 100 millions d’euros afin de permettre d’amener l’unité de valeur à 40 euros, contre 32 actuellement. Or, le projet de loi de finances pour l’année 2021 vient d’être dévoilé, et il semble que le gouvernement ait fait l’impasse sur le fait qu’en cette période de crise sanitaire et économique, le nombre de bénéficiaires de l’aide juridictionnelle va exploser, rendant insupportable le coût de leur prise en charge A PERTE, par les avocats. Il est ainsi prévu une augmentation du budget de l’aide juridictionnelle de 50 millions d’euros sur deux années, soit quatre fois moins que préconisé par le rapport PERBEN, l’unité de valeur étant portée non pas à 40 mais à 34 euros. Lorsque l’on sait qu’en raison de la grève des avocats contre la réforme des retraites et la fermeture des tribunaux pendant la période de confinement, il existe, à ce jour, une sous-consommation du budget de l’aide juridictionnelle pour 2020 qui s’élève à 84
A. J. et accès au droit
Madame Belloubet pour améliorer l’équilibre économique de nos cabinets, commencez par augmenter notre rétribution à l’aide juridictionnelle !
Dans une interview à la Gazette du Palais le 21 février dernier, Madame la Garde des Sceaux réaffirme, sans convaincre, que le système universel n’aura pas d’impact négatif pour la profession d’avocat et propose d’envisager les moyens concrets d’améliorer l’équilibre économique de nos cabinets. Nous maintenons au contraire que cette réforme entraînera une augmentation des cotisations et une baisse des pensions des avocats, particulièrement pour ceux qui ont des revenus modestes parce qu’ils assistent, défendent et conseillent les classes moyennes et populaires. Conformément à leurs règles professionnelles et à leur serment, les avocats fixent leurs honoraires notamment en fonction de la situation de fortune de leur client. Le prix de la prestation juridique est donc fonction de la capacité financière du justiciable, et souvent sans rapport avec son coût réel. Pour preuve l’assujettissement des honoraires à la TVA s’est soldé par une baisse du montant des honoraires de 14 points pour les maintenir à un niveau supportable pour les personnes physiques. Et que dire alors des avocats qui acceptent de travailler à l’aide juridictionnelle ? Les charges d’un cabinet, avant rémunération, tournent au minimum autour de 80 à 120 € HT de l’heure et cela avant le doublement des cotisations retraite
A. J. et accès au droit
Réforme et budget de l’aide juridictionnelle : de l’arlésienne aux tours de passe-passe !
Alors que la Loi de programmation et de réforme de la justice qui modifie en profondeur l’organisation judiciaire, les procédures civiles et pénales, était l’occasion d’améliorer l’accès au droit et à la justice, la grande réforme de l’aide juridictionnelle n’est toujours pas à l’ordre du jour du gouvernement. Ainsi, dans le projet de loi des finances 2020 en cours de discussion, les crédits alloués à l’accès au droit et à l’aide juridictionnelle sont réduits de 19, 3 millions d’euros, diminution maladroitement dissimulée par un jeu d’écriture comptable. On découvre également que La Loi de finance est l’occasion de modifier la loi de 1991 sur l’aide juridique par l’adoption en catimini de l’amendement des députés MOUTCHOU et GOSSELIN. S’il était définitivement adopté, les plafonds d’accès à l’aide juridictionnelle seraient fixés par décret et non plus par la Loi, cette question pourtant cruciale ne ferait donc plus l’objet d’un débat parlementaire. L’appréciation du critère de ressource serait déterminée principalement par le revenu fiscal de référence, sans tenir compte de la dégradation postérieure de la situation du justiciable. L’introduction de la possibilité pour les bureaux d’aide juridictionnelle de rejeter une demande « manifestement abusive » aboutit à une réécriture du texte qui va leur permettre
A. J. et accès au droit
Hommage à Paul BOUCHET le faiseur d’utopie
Le syndicat des avocats de France se souvient avec émotion de celui qui sut bousculer nos certitudes et partager avec ses confrères l’utopie qu’il définissait comme une anticipation militante et incarnée. Père du syndicalisme étudiant qui selon lui prépare au syndicalisme professionnel , il avait une idée concrète de l’indépendance des avocats à l’égard de l’autorité judiciaire , et sut mobiliser nos énergies pour créer à Lyon la première maison des avocats , proche mais distincte du palais de justice. Bâtonnier de 1980 à 1982, il eut le souci d’amener les avocats à moderniser leur exercice professionnel, dans une démarche d’ouverture aux acteurs de la société civile, et de solidarité notamment avec les défenseurs des paysans brésiliens sans terre. Paul Bouchet concevait l’accès au droit et à la justice comme un droit fondamental auquel devaient répondre des avocats compétents et justement rémunérés. Il a été l’artisan du remplacement du système « d’assistance juridique » en un droit pour les justiciables, « l’aide juridictionnelle », les réformes que proposèrent les commissions qu’il présida en 1990 puis 2000 furent hélas pour les plus récentes, sans suite. Lutter contre le racisme et la xénophobie, combattre la grande pauvreté par des mesures concrètes furent les axes majeurs
A. J. et accès au droit
Les giboulées de mars : Le Conseil constitutionnel censure les atteintes aux droits de la défense et aux libertés mais valide une vision de la justice purement gestionnaire.
A. J. et accès au droit
Proposition de loi B. Retailleau/E. Philippe : les libertés publiques en danger
Le gouvernement a décidé de reprendre à son compte la proposition de loi de Bruno Retailleau adoptée au Sénat le 23 octobre 2018 visant à « prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs ». Alors que la France dispose d’un arsenal législatif déjà des plus répressifs, ces nouvelles mesures si elles étaient votées porteraient gravement atteinte aux libertés publiques de toutes et tous. Les signataires appellent à s’opposer fermement à cette résurgence de la loi anticasseurs de 1970, de sinistre mémoire et abrogée en 1981. Cela marquerait un changement de paradigme avec la possibilité d’une répression inspirée des dispositions de l’état d’urgence dont le passage dans le droit commun ébranle déjà l’Etat de droit. Ce projet écarterait toujours plus la justice au profit de pouvoirs administratifs exorbitants. Fichage des manifestants, interdiction individuelle de manifester, obligation de pointage sont autant de signes de la poursuite d’une logique de suspicion généralisée et de contrôle social avec le risque de dévoiement des procédures et d’arbitraire. Les signataires dénoncent ces restrictions au droit de manifester et ces lourdes menaces sur les libertés d’opinion et d’expression des oppositions et demandent le retrait de la proposition de loi. Signataires : Ligue des droits de l’Homme