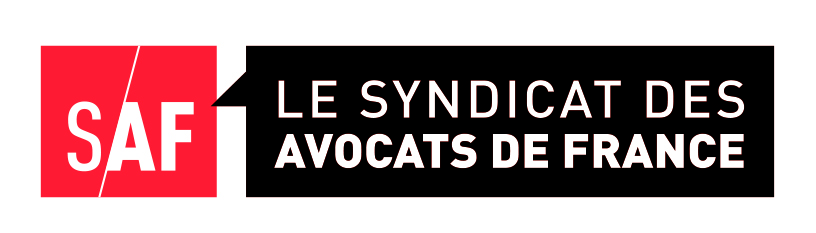Le Syndicat des avocat·es de France dénonce avec la plus grande fermeté la politique de terreur menée par les autorités de la République islamique d’Iran contre leur propre population Le SAF rappelle que ces violations massives et répétées des libertés fondamentales constituent une négation frontale, délibérée et assumée du droit international et des principes les plus élémentaires de l’État de droit. Depuis plusieurs mois, la répression exercée par les autorités iraniennes à l’encontre de la population civile, des manifestantes et manifestants, des défenseur·es des droits humains, des avocat·es, des journalistes et des minorités ethniques et religieuses se caractérise par des arrestations arbitraires massives, des actes de torture, des violences sexuelles, des exécutions sommaires et des procès manifestement inéquitables. Ces pratiques, systématiques et organisées, sont susceptibles de relever de la qualification de crimes contre l’humanité au sens du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en ce qu’elles s’inscrivent dans une attaque généralisée et systématique dirigée contre une population civile, en violation flagrante des normes fondamentales du droit international. Le Syndicat des avocat·es de France rappelle que l’Iran est lié par de nombreux instruments internationaux, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui garantissent le droit à
AIDE SOCIALE À L'ENFANCE : LES ALLOCATIONS FAMILIALES DOIVENT REVENIR AUX FAMILLES !
Toutes les actualités
À la une
Droit international
Répression en Iran : le Syndicat des avocat·es de France appelle à une mobilisation internationale
Libertés
Communiqué de presse de la section de Bordeaux : CENTRE GISÈLE HALIMI
Le SAF Bordeaux est effaré d’apprendre ce jour que la plaque du centre d’accueil de femmes et d’enfants victimes de violences, Gisèle Halimi, a été vandalisée par l’inscription d’une répugnante et odieuse croix gammée. La section condamne avec la plus grande fermeté cet acte ignoble et scandaleux de nature antisémite. De tels agissements n’ont leur place ni dans l’espace public, ni dans notre République et heurtent la dignité de toutes et tous. La section rappelle avec émotion la noblesse des nombreux combats menés par Gisèle Halimi, avocate et figure majeure de la défense des droits des femmes, dont l’engagement demeure une référence. L’évocation de son nom est indéfectiblement associée aux valeurs de liberté, d’émancipation, de lutte contre toutes les discriminations et de refus de la haine ; cet acte inqualifiable doit nous permettre de rappeler que ce nom doit continuer de rayonner. La section de Bordeaux apporte tout son soutien à l’APAFED dont elle partage pleinement le combat, ainsi qu’à la famille de Gisèle Halimi dont aucun acte, même le plus abjecte, ne pourra jamais souiller le nom.
Sur le même thème
Droit de la famille
Constitutionnalisation de l’IVG : Un leurre grossier
Dans un contexte international de régression du droit à l’IVG, le gouvernement, porté par une opinion française largement favorable à inscrire le droit à l’IVG dans la constitution, a soumis au Parlement un projet de loi constitutionnelle « visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse ». Comme son intitulé ne l’indique pas, il propose d’ajouter à l’article 34 de la Constitution, c’est-à-dire au titre des compétences du « législateur », les termes suivants : « La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse » Ce projet, actuellement débattu au Parlement, déçoit une partie de la communauté juridique et des acteur.ices de terrain qui espéraient que le texte permettrait d’empêcher un recul du droit à l’avortement. Le SAF partage cette déception et s’inquiète même de la propension du texte à ouvrir la porte à un tel recul. 1. Il est dangereux de qualifier de « liberté » un droit fondamental tel que celui d’accès à l’avortement. Certes, le Conseil d’État est d’avis que droits et libertés ont le même sens au regard du droit constitutionnel. Mais force est de constater qu’il a été décidé de choisir ici liberté
Droit de la famille
Révocation de l’arrêt Roe v. Wade : Urgence mondiale pour l’avortement
La décision de la Cour Suprême des États Unis sur le droit fédéral à l’avortement constitue un recul sans précédent du droit des femmes à disposer de leur corps. Elle témoigne du fait que rien n’est jamais acquis en matière de libertés individuelles. L’avortement constitue une nécessité sociale dont des millions de femmes risquent de se retrouver privées, au nom des convictions religieuses d’un petit nombre. Le sort des femmes états-uniennes n’est pas isolé : En Pologne, le tribunal constitutionnel a récemment rendu un arrêt rendant pratiquement impossible l’avortement tandis que le parlement vient de rejeter une proposition citoyenne pour libéraliser la loi sur l’IVG ; La Chine a récemment lancé un programme pilote de santé publique destiné à décourager les femmes de recourir à l’IVG ; Une vingtaine de pays dans le monde interdisent totalement l’avortement : Malte, Égypte, Sénégal, Nicaragua, Salvador, etc. En France, l’extrême droite a pu prendre des positions hostiles à l’avortement, les mouvements”pro-life” ont profité de la virulence des courants hostiles à l’égalité des droits entre les couples et la mise en œuvre de l’IVG demeure précaire (déserts médicaux, suppression de près de 130 centres d’IVG en 15 ans, refus des prises en charge tardives, manque de moyens donnés au
Droit de la famille
L’IFPA ou le mirage de la garantie du paiement des pensions alimentaires
En 2016, le législateur a mis en place une intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) en cas de violences conjugales, permettant à l’organisme versant des prestations familiales (CAF ou caisse de la MSA) de collecter la pension alimentaire auprès du parent débiteur pour la reverser à l’autre parent. Depuis le 1er mars 2022, ce système est devenu automatique même en l’absence d’impayés. Il s’impose pour toutes les pensions alimentaires « en numéraire » fixées par un jugement de divorce, sauf si les parents s’accordent à le refuser ou, qu’à titre exceptionnel, le juge l’estime inadaptée à la situation des parties. Toutefois en cas de violences conjugales ou familiales l’IFPA est obligatoire. Présentée à tort comme une garantie de paiement, cette intermédiation n’est en réalité adossée à aucun fonds de garantie : en cas d’impayé de la pension alimentaire par le débiteur, l’ARIPA (agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires) ne réglera pas la pension alimentaire. Comme avant, des mesures de recouvrement des pensions alimentaires seront nécessaires en cas de défaillance du débiteur. Le créancier continuera seulement de bénéficier, et uniquement s’il y est éligible, de l’Allocation de Soutien de Famille (ASF), plafonnée à 116 € par enfant. Sans résoudre le problème des