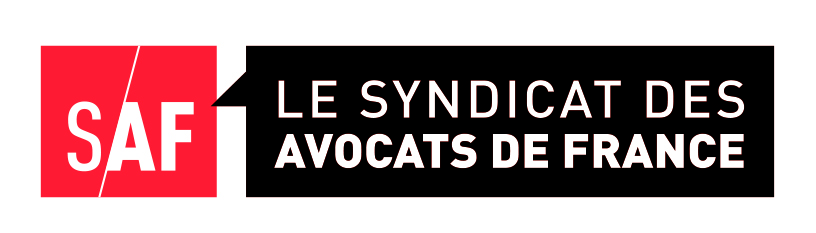C’est un jugement qui fera date : le 18 février 2021, le tribunal administratif de Rouen a donné raison aux associations en annulant pour illégalité un arrêté de la préfecture de Seine-Maritime, qui imposait aux personnes étrangères de déposer en ligne leurs demandes de titre de séjour. La motivation retenue par le tribunal s’applique en fait à toute préfecture imposant la dématérialisation. La dématérialisation ne peut être imposée aux usagers et usagères du service public : le Conseil d’Etat l’avait affirmé sans ambiguïté dans une décision du 27 novembre 2019. Mais un grand nombre de préfectures, à l’instar de la Seine-Maritime, ont choisi de tout simplement ignorer cette jurisprudence. En Seine-Maritime comme ailleurs, les personnes étrangères qui demandent un titre de séjour sont confrontées à une profonde maltraitance institutionnelle : refus d’instruction des dossiers, conditions de régularisation ubuesques et, depuis le mois de mars 2020, dématérialisation de la plupart de leurs démarches administratives. En pratique, cette dématérialisation imposée a avant tout pour effet de priver les personnes de leurs droits en les gardant à distance de l’administration. Le jugement rendu par le tribunal administratif de Rouen est, en France, le premier coup d’arrêt directement porté à une préfecture en matière de dématérialisation
Dernières actualités // février 2021
Droit des étrangers
Dématérialisation des demandes de titre de séjour : pour la première fois, un tribunal administratif juge l’organisation d’une préfecture illégale
Exercice professionnel
La loi doit être respectée: l'avocat Aytac Unsal doit être libéré immédiatement !
Notre confrère Aytaç Ünsal avait été arrêté le 12 septembre 2017, accusé aux côtés de 13 autres confrères, puis condamné l’an dernier à plus de 10 ans de prison pour « appartenance à une organisation terroriste ». Il avait entamé une grève de la faim en février 2020 avec sa consœur Ebru Timtik pour réclamer un procès équitable. Tous deux, ainsi que d’autres avocats en Turquie, ont fait l’objet de persécutions en raison de l’exercice de la profession d’avocat. Après 238 jours de grève de la faim, Ebru Timtik est décédée le 27 août 2020. Le 3 septembre 2020, Aytaç Ünsal a été libéré après 215 jour de grève de la faim par la Cour suprême en raison de son état de santé qui était incompatible avec les conditions de détention. Par conséquent, l’exécution de sa peine a été suspendu « jusqu’à ce qu’il se rétablisse » et que son état de santé s’améliore. Cependant, Aytaç Unsal a été placé en détention alors que son traitement médical est en cours et avant son rétablissement complet. En violation de la loi, la décision de reporter l’exécution rendue par la Cour suprême a été levée et il a été de nouveau incarcéré. Cette décision
Droit social
Ordonnance réformant le droit des sûretés: les salariés ne doivent pas être les dindons de la farce
L’avant-projet d’ordonnance réformant le droit des sûretés prévoit de rétrograder le « super privilège » dont bénéficient les salariés. Derrière cette réforme d’apparence technique se cache un risque de répercussions irréversibles sur les salariés. Le « super privilège » permet, en effet, aux salariés d’être payés avant la plupart des autres créanciers, en raison de la nature de leur créance, par définition alimentaire, dans le cadre des procédures collectives (redressement, liquidations, …). En outre, les salaires font également l’objet d’une garantie collective par le biais de l’AGS dans la limite d’un plafond et l’équilibre du régime pourrait également être remis en cause. En effet, l’AGS est subrogée dans les droits des salariés et bénéficie ainsi du remboursement prioritaire des sommes dont elle a fait l’avance. Compte tenu du risque élevé de défaillance des entreprises dans le contexte de la pandémie du Covid-19, les missions de l’AGS sont pourtant essentielles pendant la période actuelle. Le dernier rapport d’activité publié sur le site de l’AGS, pour 2019, démontre l’importance de récupérer les sommes avancées. Le montant des avances est de 1,488 milliards euros. Le montant des cotisations est de 833,3 millions d’euros. Le montant des récupérations est de 533,1 millions euros. Ainsi, le risque est à
Exercice professionnel
Réduction des délais de traitement de la Justice : tentative de blanchiment
Les objectifs du groupe de travail sur la réduction des délais de traitement de la Justice se précisent : l’Inspection générale de la Justice a rédigé à son attention, en vue de sa seconde réunion, une note sur les « règles et vecteurs procéduraux permettant de faciliter le traitement des affaires pénales et civile ». Sous cette appellation pudique, se cache la volonté de poursuivre le rationnement des droits résultant des dispositions votées ces dernières années, notamment dans la loi du 23 mars 2019, pour restreindre le flux des affaires, ou les traiter de manière simplifiée au détriment de la qualité de la décision judiciaire. Ce texte posait déjà les jalons d’un modèle de justice qui n’en a plus que le nom : éviter que les justiciables saisissent la justice, ou les obliger à saisir la justice par la voie dématérialisée, instaurer des chausses trappes de procédure pour écarter certaines saisines, supprimer l’audience et le débat judiciaire, ou ne l’organiser qu’en visioconférence, et ne motiver qu’exceptionnellement la décision, quand la « beauté du geste » juridique le justifie. En 2018 et 2019, la mobilisation des professionnels de justice avait contraint la chancellerie à revoir ses ambitions à la baisse. Le ministère restait sur sa faim. C’est
Libertés
Le Syndicat des Avocats de France passe au crible le projet de loi « confortant » le respect des principes de la République
Le Syndicat des Avocats de France (SAF) a analysé et présenté, de façon complète et didactique, les propositions du projet de loi sous forme de tableau commenté, au regard de l’état actuel du droit. Comme l’a relevé le Conseil d’État, le projet touche pratiquement à tous les droits et libertés publiques constitutionnellement et conventionnellement garantis. Il prend exclusivement le parti de les restreindre, alors que « la meilleure réponse à apporter [aux dangers visés] réside d’abord dans la défense et l’affirmation de ces lois et libertés ». Dans la plupart des cas, les dispositions du projet restreignent considérablement de nombreuses libertés sans souci d’équilibre ni de proportionnalité, et sans que l’on puisse en attendre une quelconque efficacité par rapport aux dispositifs existants. Le projet contient une série de mesures inutiles, incantatoires, voire dangereuses, qui remettent en cause des principes consacrés depuis le XIXème siècle, et demeurent à ce jour des emblèmes de la République : la liberté d’association, la liberté de conscience et de culte, la liberté de réunion, la liberté d’expression, d’opinion et de communication, la liberté de la presse, la liberté de l’enseignement, la liberté du mariage ou encore la liberté contractuelle. Les faiblesses du projet tiennent à sa philosophie générale
Droit des étrangers
Jeunes majeurs étrangers, sortir de l’impasse
L’actualité a mis au grand jour la situation de jeunes étrangers présents depuis des années en France, arrivés soit mineurs isolés, soit avec leur famille, en cours d’études, d’apprentissage, accédant à l’emploi souvent dans des secteurs en pénurie de main- d’œuvre et soudain victimes de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire (OQTF) dès lors qu’ils arrivent à leur majorité. Nous nous réjouissons évidemment que plusieurs de ces jeunes aient trouvé une solution heureuse avec l’obtention d’un titre de séjour grâce à la solidarité que leur situation a suscitée. Au-delà de ces cas emblématiques, les jeunes en détresse sont nombreux. Depuis des années, associations, enseignants, éducateurs, chefs d’entreprise, maîtres d’apprentissage, élus sonnent l’alarme et ne sont pas entendus. Nous sommes quotidiennement témoins d’un terrible gâchis humain et social : voir des jeunes être menacés d’expulsion, réduits à vivre dans la peur, l’errance et la clandestinité, alors que la France est devenue leur pays, celui de leurs liens, de leurs amitiés, de leurs amours, et qu’ils sont prêts à rendre à la société ce qu’elle a investi dans leur formation. Pourtant, dès aujourd’hui, il y a des possibilités d’amélioration réelle et immédiate pour au moins réduire l’arbitraire des préfectures : –
Droit des étrangers
Dématérialisation imposée pour les titres de séjour : la préfecture de la Vienne devant le tribunal administratif
La Cimade, le Gisti, la Ligue des droits de l’Homme et le Syndicat des avocats de France ont saisi le tribunal administratif de Poitiers suite à la récente décision de la préfecture de rendre obligatoire l’obtention d’un rendez-vous par Internet pour demander un titre de séjour. Il est de plus en plus fréquent que les préfectures soient condamnées pour leurs pratiques abusives en la matière. Le 27 novembre 2019, le Conseil d’État rendait une décision limpide : la réglementation « ne saurait avoir légalement pour effet de rendre obligatoire la saisine de l’administration par voie électronique ». Ainsi, il est illégal qu’une administration contraigne son public à utiliser Internet pour accomplir tout ou partie de ses démarches. Pourtant le 3 décembre 2020, la préfecture de la Vienne informe ses usagers et usagères qu’un certain nombre de catégories de première demande de titre de séjour ne pourront désormais être déposées qu’après l’obtention d’un rendez-vous via le téléservice démarches-simplifiées.fr. Sont par exemple concerné·es les parents d’enfant français, les personnes faisant valoir le respect de leur vie privée et familiale, les personnes gravement malades… Les personnes devant renouveler leur titre de séjour sont elles aussi contraintes d’obtenir un rendez-vous en ligne. Lorsque des dates sont proposées, elles sont souvent lointaines, pouvant aller jusqu’à 5 à 6 mois d’attente.
Défense pénale
UNE VICTOIRE AMÈRE : LA DÉTENTION PROVISOIRE AUTOMATIQUE CENSURÉE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL MAIS SANS EFFET JURIDIQUE POUR LES PERSONNES CONCERNÉES !
Par une décision du 29 janvier 2021, le Conseil Constitutionnel déclare non conforme à la Constitution l’article 16 de l’ordonnance du 25 mars 2020 permettant lors du premier confinement la prolongation automatique et sans juge des détentions provisoires que nous avions immédiatement attaquée devant le Conseil d’État. A l’aube d’un 3ème confinement, espérons que cette décision obtenue par le SAF et d’autres organisations guidera la main de l’exécutif lorsqu’il s’apprêtera à rédiger de nouvelles ordonnances. C’est en effet un sérieux rappel à la loi infligé au gouvernement ainsi qu’au Conseil d’État qui une fois encore avait validé sans broncher cette atteinte pourtant manifeste aux libertés fondamentales. Pour autant, la motivation du Conseil constitutionnel interroge à plusieurs égards. D’une part, alors que nous soutenions que l’intervention du juge est nécessairement PRÉALABLE à la décision de privation de liberté et à sa prolongation, les juges de la rue Montpensier laissent la porte ouverte à un contrôle juridictionnel a posteriori s’il intervient à bref délai. D’autre part, et sans surprise, les effets donnés à cette décision ne sont que symboliques. Au nom de la sauvegarde de l’ordre public, de la recherche des auteurs d’infractions et dès lors que les dispositions de l’ordonnance litigieuse