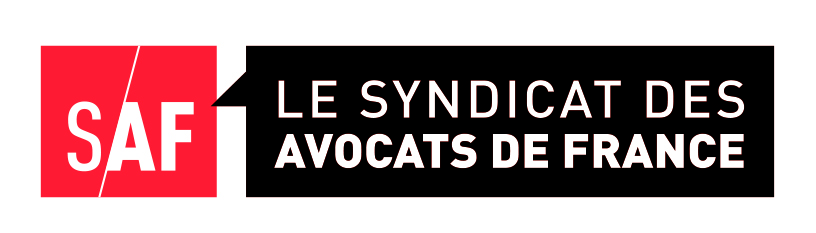46e CONGRÈS DU SAF Grenoble – 8, 9 et 10 novembre 2019 Quand quitte-t-on l’État de droit ? La question posée par l’historien Johann Chapoutot dans le dernier numéro de la revue Délibéré à propos de l’Allemagne en 1933, n’a jamais été aussi actuelle. Interdiction de manifester, criminalisation de l’espace public, répression sans précédent des manifestant.e.s, recours systématique aux armes, la réponse de l’exécutif au mouvement des gilets jaunes questionne l’État de droit. Les gilets jaunes ont ainsi découvert la violence policière, quotidien des jeunes vivant à la périphérie des villes. La disparition de Steve fait écho à la demande de justice pour Adama Traoré. La quasi-impunité des violences policières interroge l’efficacité et l’indépendance des autorités de contrôle de l’État. Le rôle assumé par certains procureurs, comme ceux de Paris ou de Nice, d’accorder la priorité au maintien de l’ordre, questionne l’équilibre démocratique, tout comme la sévérité des peines prononcées par les juges du siège, notamment les interdictions de manifester ou de séjour dont le but est de décourager les citoyens de continuer à s’inscrire dans l’espace public. Interpellé à propos des violences policières et de l’utilisation des Lanceurs de Balles de Défense – les LBD 40 – lors des
Dernières actualités // septembre 2019
Non classé
DÉMOCRATIE SERVICE MINIMUM : violences d’état – légitimes défenses
Droit des étrangers
Le projet de code de la justice pénale des mineurs: des propositions inadaptées pour lutter contre l'enfermement des enfants
Au 1er juillet 2019, 882 adolescent.e.s étaient incarcéré.e.s, chiffre jamais atteint depuis plus d’une vingtaine d’années. Il faut y ajouter le nombre d’enfants placés dans l’un des 52 centres fermés, ceux placés en psychiatrie ou en centres de rétention, ainsi que le chiffre gris des jeunes condamnés en tant que majeur.e.s pour des faits commis du temps de leur minorité. Pourtant, la Garde des Sceaux et la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse avaient assuré que certaines mesures d’application immédiate introduites dans la loi de programmation 2018-2022 de réforme pour la Justice du 23 mars 2019, permettraient une diminution du nombre d’enfants placés en détention provisoire, notamment grâce à l’encadrement des conditions de révocation du contrôle judiciaire et à la réduction de la durée du maintien en détention provisoire des mineur.e.s de 13 à 15 ans une fois l’instruction terminée. Force est de constater que ces mesures n’ont eu en réalité aucun impact. Que dire alors du projet de code de la justice pénale des mineurs déposé le 11 septembre 2019 en Conseil des ministres, dont la diminution de l’incarcération des mineur.e.s est l’un des objectifs affichés ? Si ce projet se présente comme « innovant » et « tourné vers l’éducatif »,
Droit social
Plafonnement des indemnités : les juges du fond résistent, la bataille juridique continue !
Aujourd’hui étaient attendues les décisions des Cours d’appel de Paris et de Reims au sujet du plafonnement des indemnités pour licenciement injustifié. La Cour d’appel de Paris a reporté sa décision au 30 octobre 2019 (sur un dossier complexe, qui ne porte pas que sur le barème et pourrait être traité sans aborder ce sujet si la Cour reconnaissait la nullité du licenciement). La Cour d’appel de Reims a quant à elle rendu trois arrêts (portant sur les jugements très commentés rendus par le Conseil de prud’hommes de Troyes en décembre 2018), qui confortent la pertinence de notre combat juridique et judiciaire contre ce plafonnement tellement injuste pour les salariés. Comme nous l’avions déjà rappelé en juillet dernier (http ://lesaf.org/bareme-macron-un-avis-mais-pas-un-coup-darret/), les juges ne sont pas liés par les avis rendus par la Cour de cassation et elle-même n’est d’ailleurs pas liée par ses propres avis. Contrairement aux avis publiés par la Cour de cassation le 17 juillet 2019, la Cour d’appel de Reims admet tout d’abord l’applicabilité directe de l’article 24 de la Charte sociale européenne entre particuliers, donc la possibilité pour les salariés de l’invoquer dans un litige à l’encontre de leur employeur. La Cour analyse ensuite les divers écueils
Droit de la famille
Le projet de loi bioéthique : Des avancées majeures mais une réforme mineure de la famille
La règle de droit n’est acceptable que si elle est le « pur produit d’une société et d’une culture en un temps et un espace donnés » : les avocat.es qui défendent celles et ceux qui font famille le savent bien. 25 ans après l’adoption de la première loi bioéthique, 6 ans après l’adoption du mariage pour tous et après 2 semaines de débats de grande qualité en commission spéciale, l’Assemblée nationale s’apprête à examiner le projet de loi relatif à la bioéthique. Ouvrir la procréation médicalement assistée à toutes les femmes était une promesse du candidat Macron, une fois élu, il a fait le choix politique d’intégrer cette question aux débats relatifs à la révision de la loi bioéthique. Ce choix n’est pas neutre. Bien sûr la possibilité pour toutes les femmes qu’elles soient seules, ou en couple, de recourir à la procréation médicalement assistée doit être saluée comme une réforme majeure car elle est une mesure d’égalité, en phase avec l’évolution de la société et des individus qui font famille. De même permettre aux enfants nés de dons d’avoir accès aux données non identifiantes de leur donneur est un bon compromis pour l’accès aux origines sans remettre en question l’accouchement sous
Défense pénale
Décision du Conseil Constitutionnel sur le recours à la visio-audience: une victoire en trompe l’œil
Le Conseil constitutionnel confirme que le recours à la télé-audience entraîne une atteinte à l’exercice des droits de la défense et juge que cette atteinte est excessive lorsque la loi permet qu’une personne placée en détention provisoire puisse se voir interdire durant un an de comparaître physiquement devant un juge lorsqu’elle présente une demande de mise en liberté, ce qui est le cas actuellement en matière criminelle. La solution posée par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2019- 802 du 20 septembre 2019 résulte d’une mobilisation des avocats contre la généralisation des dispositifs de visioconférence dans les différents contentieux. Le Syndicat des Avocats de France a toujours et systématiquement marqué son opposition au recours à ce dispositif de télé-audience qui procède d’un démembrement scandaleux de l’audience, d’un éloignement et une mise à l’écart du justiciable. A cet égard, est salutaire le rappel de ce qu’un procédé de visioconférence n’a rien d’équivalent avec le déroulement normal de la justice, ce qu’avait déjà retenu le Conseil constitutionnel dans sa décision 2019-778 du 21 mars 2019 « loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ». Rappelons que dans cette décision le Conseil constitutionnel avait courageusement estimé qu’ « eu égard à l’importance de
Exercice professionnel
Par-delà les différences de nos statuts et de nos exercices, notre combat pour le droit à une retraite fiable, digne et solidaire est le même !
À l’heure où le mouvement de grève des salariés de la RATP est spectaculaire par son ampleur et que se profilent plusieurs cortèges les 16, 21 et 24 septembre prochain contre le projet de réforme des retraites, le SAF apporte son soutien aux différentes actions syndicales en cours. La preuve est faite désormais que le projet de réforme des retraites fait l’unanimité contre lui et cristallise les oppositions de professions multiples, des salariés aux fonctionnaires en passant par les professions libérales. Tous ces gens, tous ces métiers ne sauraient avoir tort ensemble ! Tous ne sauraient être taxés de défendre des intérêts corporatistes ! Lorsque chacun constate, du conducteur de métro aux avocats, que la retraite qu’on nous promet va fracturer un peu plus les solidarités et ouvrir la voie aux retraites privées, ce n’est pas du corporatisme mais de la clairvoyance ! Ce que nous voulons tous, c’est être entendus. Or, les auteurs du projet de réforme se paient de mots en brandissant une concertation de pure façade et une solidarité collective à l’opposé de ce qui se prépare ! Les discours ne nous trompent pas et au travers des mécanismes du projet, nous lisons qu’aucune des propositions syndicales n’est prise en compte,
Exercice professionnel
Ensemble à Paris le 16 septembre prochain pour un système de retraite juste et solidaire !
Aujourd’hui le système de retraite spécifique des avocats est basé sur un régime autonome et solidaire. Son financement est assuré pour le régime dit « de base » par une cotisation forfaitaire, graduée selon l’ancienneté (qui donne à tous et toutes la même retraite de base, soit 1402€ par mois). Pour le régime dit complémentaire (né en 1978) mais obligatoire comme l’est l’AGIRC ARCO pour les salariés du privé et du public, la cotisation est proportionnelle et augmente avec les revenus. Ainsi, plus on gagne, plus on paye et meilleur est le taux de remplacement, le moment de la retraite venu. Or, le projet de réforme des retraites , qui sous couvert de simplification, propose de fusionner tous les régimes dans un seul système universel par points veut remettre en cause cette solidarité. Le système de retraite par points que le gouvernement veut mettre en place abrogera la solidarité et empêchera toute progressivité. La réforme conduira à une augmentation importante des cotisations et une baisse des pensions. La dégressivité du futur régime fera peser la charge de cotisations la plus lourde sur les revenus les plus bas. Ainsi pour des revenus annuels de 0 à 40 000 €, le taux global s’élèvera à 28,12 % tandis qu’il ne
Libertés
Observer l'action de la police et de la gendarmerie est un droit! Soutien à Camille Halut
Les observatoires des libertés publiques participent depuis plusieurs années au respect des droits fondamentaux. La Ligue des droits de l’Homme (LDH), depuis sa fondation en 1898, comme d’autres organisations, agit dans ce sens. Camille Halut, membre d’un Observatoire des libertés publiques – la Legal Team de la LDH Montpellier – est aujourd’hui poursuivie pénalement pour son activité en matière de défense des droits fondamentaux. Camille Halut a participé à l’observation des pratiques des forces de police et de gendarmerie en matière de maintien de l’ordre public, lors du mouvement des « gilets jaunes ». Ses observations ont ainsi permis la rédaction de plusieurs rapports, dont l’un a été produit devant le Conseil d’Etat dans le cadre du référé liberté tendant à l’interdiction de l’usage des LBD 40. Ses observations ont également servi de support à des saisines de l’IGPN et ont, notamment, participé à l’identification de l’auteur d’un tir de LBD 40 sur un manifestant pacifique, au cours d’une manifestation à Montpellier. Dans le cadre de sa mission d’observatrice, elle a été victime d’insultes et de violences policières, comme d’autres observateurs. Convoquée au commissariat pour une audition libre, Camille Halut a été immédiatement mise en garde à vue et renvoyée ensuite à
Défense pénale
INDÉPENDANCE DES INSPECTEURS DU TRAVAIL LES ENTRAVES NE DOIVENT PAS ÊTRE PASSÉES SOUS SILENCE !
À la suite d’une plainte déposée par la société TEFAL, Laura Pfeiffer, inspectrice du travail, a été poursuivie pour recel et violation du secret professionnel. Laura Pfeiffer a été condamnée le 16 novembre 2016 par la Cour d’appel de Chambéry pour recel de violation du secret professionnel. La Cour de cassation a censuré cet arrêt, estimant que la situation de Laura Pfeiffer n’avait pas été examinée au regard de la loi sur les lanceurs d’alerte instituant une cause d’irresponsabilité pénale au bénéfice de la personne ayant, dans certaines conditions, porté atteinte à un secret protégé par la loi. Laura Pfeiffer sera donc à nouveau jugée devant la Cour d’appel de Lyon le 12 septembre prochain. Par quelle singulière conception de l’ordre public, un procureur en est-il venu à poursuivre une inspectrice du travail ayant révélé les pressions exercées par sa hiérarchie à la demande de TEFAL pour obtenir son éviction plutôt que de s’attaquer aux entraves à l’exercice des missions de cet agent ? Les atteintes à l’indépendance de l’inspection du travail résultant des pratiques inadmissibles de la société TEFAL ont pourtant été caractérisées par le Conseil National de l’Inspection du travail dans un avis n°13-003 rendu le 10 juillet 2014