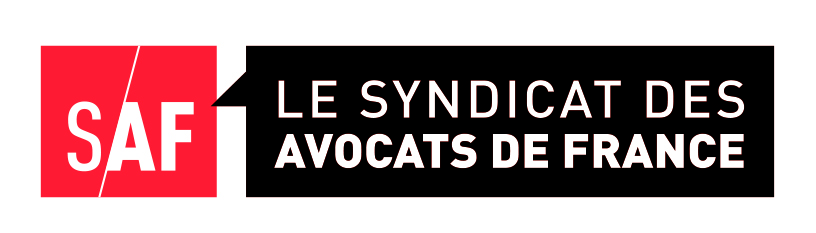Alors que personne ne connait encore le projet du gouvernement sur la réforme des retraites et ses possibles répercussions sur le système de retraite des avocats, le SAF qui participe activement à la gouvernance de la CNBF, entend rappeler son attachement au principe de solidarité régissant la retraite des avocats, entre les générations et entre les avocats quelques soient leurs revenus.
Avec la profession unie, nous mettrons tout en œuvre pour maintenir ces principes fondamentaux de protection sociale, garantis par une gestion autonome des retraites par la CNBF, parce que :
- Le régime de retraite des avocats est l’un des plus solidaires : le régime de base permet à tous les avocats d’obtenir le même socle de pension, quels que soient les revenus sur lesquels ils ont cotisé ;
- Il prend en compte la spécificité d’une profession pour laquelle les accidents de parcours et les variations de revenus sont courants ;
- Il permet de verser à cotisation identique une pension de base plus importante que celle des autres régimes ;
- Les régimes complémentaires permettent, pour leur part à ceux qui ont plus de revenus, de cotiser plus pour rester fidèles à leur carrière ;
- La caisse gère l’aide sociale, avec l’appui des délégués et des ordres qui connaissent les consoeurs et les confrères, ce que ne pourra pas assurer, par exemple, l’Urssaf ;
- La bonne gestion du régime de retraite par la CNBF permet de faire baisser le coût de gestion, bien inférieur à ceux des autres régimes et des assureurs privés ;
- La caisse dispose de réserves permettant l’équilibre jusqu’en 2083 (et participe ainsi à la solidarité interprofessionnelle).
Aujourd’hui et malgré toutes les imperfections et les critiques qui peuvent être faites, un régime de retraite autonome pour les avocats permet tout à la fois d’assurer l’indépendance de la profession et la solidarité entre nous.
Les projets d’absorption du régime et de mise en place d’un régime par points exclusivement proportionnel aux revenus conduiraient à supprimer nos principes de solidarité, mettre fin à la prise en compte de la spécificité de nos parcours professionnels, augmenter les cotisations tout en réduisant les prestations.
C’est aussi l’indépendance de notre profession qui est questionnée.
Pour préserver ce socle commun, c’est l’ensemble de la profession qui doit se mobiliser.
La décision du Conseil constitutionnel validant la loi instituant la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise marque une étape grave pour l’équilibre de notre système judiciaire et pour les droits des justiciables. En consacrant ce « legal privilege à la française », le Conseil constitutionnel admet de façon contestable la création d’un nouveau secret au bénéfice des entreprises, opposable dans les procédures civiles, prud’hommales, commerciales et administratives, tout en l’assortissant de réserves d’interprétation limitées. En effet, la loi permettra ainsi, sous certaines conditions, de soustraire à la production judiciaire des documents juridiques internes, même lorsque ceux-ci sont déterminants pour la manifestation de la vérité. Cela constitue une atteinte grave, directe et manifeste au droit à la preuve. Depuis des années, il est démontré que ce mécanisme ne vise pas la protection des droits de la défense mais la protection stratégique des entreprises. Il offrira un argument procédural pour refuser la communication de pièces potentiellement décisives : connaissance d’un risque industriel, travail dissimulé, fraude, atteinte à l’environnement ou sécurité des consommateurs. En validant ce dispositif, le Conseil constitutionnel consacre une logique d’opacité incompatible avec le droit à un procès équitable. La preuve devient plus difficile, voire impossible pour la partie la plus faible : salarié.e,