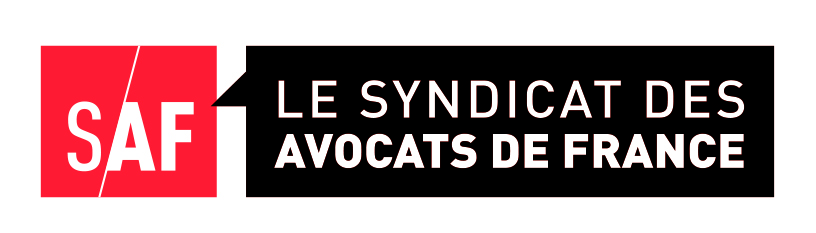Le 11 février 2026, le Garde des Sceaux a diffusé une circulaire intitulée « circulaire de politique pénale et éducative relative à la justice des mineurs », qui « expose la nouvelle conception du placement, et réaffirme [l’]ambition de renforcer l’intervention en milieu ouvert ». Le Ministre de la Justice juge et disserte sur « la réussite éducative » des enfants, pour ne pas assumer l’échec des politiques coercitives et du manque de moyens alloués à la justice des enfants. Il est prévu la création d’« un nouveau modèle » les « unités judiciaires à priorité éducative », les UJPE, en lieu et place des CEF (d’abord du secteur public, puis du secteur habilité) et des Unités Educatives d’Hébergement Collectif. Fin novembre 2025, la fin des centres éducatifs fermés (CEF) avait été annoncée. Nos organisations ne pouvaient que s’en réjouir, tant ces structures mobilisent des moyens colossaux pour une pertinence contestable et contestée[1], au détriment des mesures de milieu ouvert et des alternatives à l’enfermement. Mais, encore une fois, derrière une annonce s’en cache une autre. Tout d’abord, ne disparaissent immédiatement que les CEF du secteur public, et non les CEF du secteur habilité. Les CEF, pour le moment, ne disparaissent donc qu’à moitié. Bien plus, nos organisations ne peuvent
Dernières actualités // Droit des Mineurs
Droit des Mineurs
Mineurs non accompagnés : 3e condamnation de la France par le Comité des droits de l’enfant
Le 19 janvier 2026, le Comité des droits de l’enfant des Nations unies a, une nouvelle fois, condamné la France pour ses pratiques en matière de prise en charge et de détermination de l’âge des mineurs non accompagnés. Le Comité a été saisi par cinq jeunes exilés dont la minorité a été contestée dans les départements de Haute-Garonne, de la Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire. Leurs parcours révèlent des pratiques administratives et judiciaires défaillantes : évaluations sommaires basées sur l’apparence physique, rejet de documents d’état civil pourtant authentiques, et recours systématique à des tests osseux pourtant unanimement critiqués. L’un d’entre eux a même fait l’objet d’une réévaluation de son âge alors qu’un autre département l’avait reconnu mineur. Privés de représentant légal, ces enfants ont été remis à la rue sans recours suspensif, les exposant durablement à des situations de danger. Il s’agit de la troisième condamnation de la France, après celles de janvier 2024 et mai 2025, visant les mêmes défaillances structurelles. La répétition de ces constats souligne le caractère persistant et systémique des violations, malgré les alertes réitérées des associations intervenant auprès des mineurs isolés. Dans cette décision, le Comité relève à nouveau que les procédures françaises de détermination de l’âge
Droit des Mineurs
Un doublé historique pour les droits des enfants !
Le Syndicat des Avocat.es de France se réjouit de deux votes intervenus ce jeudi 11 décembre à l’assemblée nationale en faveur des droits des enfants. Un.e avocat.e pour chaque enfant en assistance éducative : une question d’égalité Le premier est l’adoption unanime de la proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à disposer d’un.e avocat.e dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative. Par ce vote historique, les députés valident des années de combats des anciens enfants placés et de nombreux professionnels pour que l’un des droits fondamentaux garantis par la Convention internationale des droits de l’enfant soit enfin respecté et rendu effectif. Un an après la commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques de protection de l’enfance ayant mis en lumière le caractère systémique et l’ampleur des défaillances de cette politique publique, vingt-quatre heures après la révélation d’un nouveau drame subi par un enfant sous protection institutionnelle, le vote de cette proposition de loi réaffirme que la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant réside dans le respect de ses droits et ouvre une occasion historique de changer la donne. Les avocat.e.s d’enfants sont prêt.e.s et le SAF, engagé de longue date pour la défense des droits
Droit des Mineurs
Protection de l'enfance : des avancées historiques attendues le 11 décembre
À quelques jours de la Journée internationale des droits de l’enfant du 20 novembre, et alors que 381 000 enfants sont placé·es à l’aide sociale à l’enfance (ASE) en France, la Conférence des présidents de l’Assemblée nationale a validé l’examen de deux propositions de loi majeures le 11 décembre 2025. Issues d’un large travail réunissant militant·es, personnes concernées et professionnel·les, elles doivent mettre fin à une situation intolérable : en 2025, des enfants placé·es ou isolé·es sont encore privés de droits garantis par la Convention internationale des droits de l’enfant. Elles réaffirment la primauté de leur intérêt supérieur et ouvrent une occasion historique de changer la donne. De la reconnaissance des violences à l’action politique Un an après la commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques de protection de l’enfance ayant mis en lumière le caractère systémique des violences institutionnelles, ces textes traduisent enfin une volonté d’agir pour renforcer la protection des enfants. Un avocat pour chaque enfant placé ou suivi par l’ASE : vers l’égalité des droits. Aujourd’hui, tous les enfants faisant l’objet d’une procédure d’assistance éducative n’ont pas les mêmes droits : certains peuvent être accompagnés par un avocat, d’autres non. Cette inégalité crée une rupture d’accès à la justice,
Droit des Mineurs
Fermeture de l’EPM de Marseille : Une recommandation qui s’impose
Dans un rapport publié au Journal Officiel le 29 août 2025, la Contrôleure Générale des Lieux de Privation de Liberté alerte sur la violation grave des droits fondamentaux des mineurs privé·es de liberté au sein de l’EPM de Marseille « La Valentine », et préconise dans ses recommandations la fermeture, au moins partielle, de l’établissement. Cette recommandation exceptionnelle démontre l’urgence de la situation. Le rapport met en exergue l’indignité des conditions matérielles de prise en charge des mineur·es détenu·es ainsi que les conséquences catastrophiques de la démobilisation et de l’absence du personnel pénitentiaire et éducatif. Nous dénonçons ces conditions de détention des enfants et adolescent.es indignes et attentatoires aux droits des mineur·es incarcéré·es. Le rapport de la CGLPL fait état de « violences psychologiques et de mesures constitutives de traitements inhumains et dégradants », ce qui justifie amplement la demande de fermeture de cette prison pour mineur.es. Parmi les éléments relevés par la mission de la CGLPL, une pratique gravement attentatoire aux droits des mineur.es dénommée « mise en grille » couramment appliquée pour punir les enfants nous alerte particulièrement. Cette mesure d’une gravité exceptionnelle consiste à enfermer un enfant « dans un des trois locaux barreaudés, dépourvus d’assises, de point d’eau potable et de WC, situés
Droit des Mineurs
Multiplication des arrêtés « couvre-feu » pour les mineur.es : des mesures liberticides à défaut d'une politique ambitieuse en faveur des jeunes en difficulté
Le SNPES-PJJ/FSU, le Syndicat de la Magistrature, le Syndicat des Avocats de France dénoncent la multiplication dans plusieurs villes de France des arrêtés « couvre-feu » à l’encontre de mineur.es de moins de 16 ans (Nîmes, Béziers, Limoges …). Ces mesures sécuritaires ciblant certains quartiers populaires amplifient la discrimination et la stigmatisation dont les habitant.es, et en premier lieu la jeunesse, sont déjà victimes. Ces dispositions entravant particulièrement les libertés individuelles, dont la liberté de circulation, reposent principalement sur des procès d’intention et la politique du « tous coupables. » Elles constituent une dérive grave du pouvoir politique qui vise toujours plus à se substituer au pouvoir judiciaire. Pour nos organisations syndicales, de telles privations ne devraient être prononcées que par la justice, de manière individuelle et non collective. Aussi, ces annonces interviennent alors que les services de la PJJ dans les territoires concernés sont confrontés à de grandes difficultés liées au manque de moyens et à une surcharge d’activité. Pour exemple, la situation du Gard est extrêmement préoccupante avec 3 postes éducatifs supprimés laissant près de 80 jeunes sans suivi à la rentrée. Soi-disant motivées par la lutte contre le trafic de produits stupéfiants, ces mesures court-termistes ne sauraient dissimuler l’absence totale de
Droit des Mineurs
Le Conseil constitutionnel refuse de casser la justice pénale des mineurs, exigeons qu’elle soit désormais réparée
Le Conseil constitutionnel a décidé hier, jeudi 19 juin, de censurer de nombreuses dispositions de la loi « visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leur parents ». Ont ainsi été déclarées contraires au principe fondamental reconnu par les lois de la République d’adaptation de la réponse pénale à la situation des mineurs : La création d’une comparution immédiate pour les mineurs, L’extension de la possibilité de recourir à l’audience unique pour les mineurs âgés de 13 à 16ans, L’allongement de deux mois à un an de la durée totale de détention provisoire applicable aux mineurs de moins de seize ans pour certains délits, La possibilité de placer un mineur en rétention judiciaire pour non-respect d’une mesure éducative judiciaire provisoire. Le Conseil constitutionnel a également rappelé que l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge est une exigence constitutionnelle qui n’est pas respectée par le législateur en ce que les modifications législatives aboutissent en réalité à « inverser la logique selon laquelle l’atténuation des peines applicable aux mineurs est le principe et l’absence d’atténuation l’exception. » Enfin, l’expérimentation visant à augmenter le nombre d’assesseurs devant le tribunal pour enfant statuant en matière criminelle a été
Droit des Mineurs
Casse de la justice pénale des mineur·es : qui va payer ?
Après de longs mois de débats parlementaires marqués par des désaccords extrêmement forts, et malgré une opposition unanime des professionnel.les de l’enfance, le Sénat a définitivement voté ce 19 mai la proposition de loi visant à aménager le code de la justice pénale des mineurs et certains dispositifs relatifs à la responsabilité parentale ». C’est dans un hémicycle quasiment vide que le Sénat a porté le coup final, franchissant ainsi une nouvelle étape dans le processus de destruction de la justice pénale des mineur.e.s telle qu’elle avait été envisagée par l’ordonnance de 1945. Comparution immédiate, pénalisation des parents, recours élargi à l’audience unique, remise en cause du principe de l’atténuation de responsabilité pour les mineur.es, autant de dispositions inutiles et en contradiction totale avec les grands principes régissant la matière. Cette réforme populiste, motivée par des obsessions sécuritaires, élaborée sans aucune étude d’impact et contre l’avis de l’ensemble des professionnel.les de l’enfance, consacre l’hégémonie du répressif au détriment de l’éducatif. Cette loi d’affichage ne répond à aucun des enjeux auxquels la justice des mineur.es est confrontée et ne vise qu’à cacher la réalité du délabrement de la justice et l’abandon de l’ensemble des services publics qui entourent l’enfance. La justice dispose
Droit des Mineurs
Lundi 5 mai 2025 : Journée de mobilisation pour la Justice Pénale des mineurs
Le lundi 5 mai 2025 à 12H30 devant votre Tribunal Judiciaire JOURNÉE DE MOBILISATION EN FAVEUR DE LA JUSTICE PÉNALE DES MINEURS Le 6 mai 2025,la proposition de loi, modifiée par le Sénat, « visant à aménager le code de la justice pénale des mineurs et certains dispositifs relatifs à la responsabilité parentale », sera examinée par la Commission Mixte Paritaire Ce texte envisage des mesures qui notamment : – abrogent les principes constitutionnels essentiels d’atténuation de peine et de primauté de l’éducatif sur le répressif – prévoient l’instauration d’une comparution immédiate pour les mineurs récidivistes de plus de 15 ans – la création de courtes peines de prison de moins d’un mois – la rétention d’un enfant dans un commissariat, un local de police, lorsqu’il est seulement soupçonné de ne pas respecter une mesure éducative – L’assignation à résidence sous surveillance électronique d’un enfant dès 13 ans – des sanctions notamment financières contre les parents Alors que : – la justice des mineurs manque de moyens matériels et humains – la prévention et la protection de l’enfance sont exsangues – les services éducatifs doivent disposer du temps nécessaire pour intervenir – les droits de la défense ne pourront s’exercer efficacement dans cette justice d’urgence