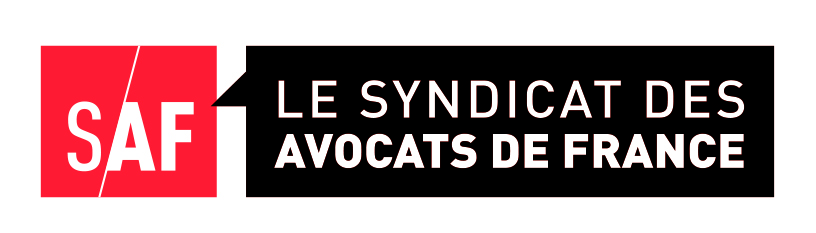Alors que personne ne connait encore le projet du gouvernement sur la réforme des retraites et ses possibles répercussions sur le système de retraite des avocats, le SAF qui participe activement à la gouvernance de la CNBF, entend rappeler son attachement au principe de solidarité régissant la retraite des avocats, entre les générations et entre les avocats quelques soient leurs revenus.
Avec la profession unie, nous mettrons tout en œuvre pour maintenir ces principes fondamentaux de protection sociale, garantis par une gestion autonome des retraites par la CNBF, parce que :
- Le régime de retraite des avocats est l’un des plus solidaires : le régime de base permet à tous les avocats d’obtenir le même socle de pension, quels que soient les revenus sur lesquels ils ont cotisé ;
- Il prend en compte la spécificité d’une profession pour laquelle les accidents de parcours et les variations de revenus sont courants ;
- Il permet de verser à cotisation identique une pension de base plus importante que celle des autres régimes ;
- Les régimes complémentaires permettent, pour leur part à ceux qui ont plus de revenus, de cotiser plus pour rester fidèles à leur carrière ;
- La caisse gère l’aide sociale, avec l’appui des délégués et des ordres qui connaissent les consoeurs et les confrères, ce que ne pourra pas assurer, par exemple, l’Urssaf ;
- La bonne gestion du régime de retraite par la CNBF permet de faire baisser le coût de gestion, bien inférieur à ceux des autres régimes et des assureurs privés ;
- La caisse dispose de réserves permettant l’équilibre jusqu’en 2083 (et participe ainsi à la solidarité interprofessionnelle).
Aujourd’hui et malgré toutes les imperfections et les critiques qui peuvent être faites, un régime de retraite autonome pour les avocats permet tout à la fois d’assurer l’indépendance de la profession et la solidarité entre nous.
Les projets d’absorption du régime et de mise en place d’un régime par points exclusivement proportionnel aux revenus conduiraient à supprimer nos principes de solidarité, mettre fin à la prise en compte de la spécificité de nos parcours professionnels, augmenter les cotisations tout en réduisant les prestations.
C’est aussi l’indépendance de notre profession qui est questionnée.
Pour préserver ce socle commun, c’est l’ensemble de la profession qui doit se mobiliser.
Le Syndicat des Avocat.es de France se réjouit de deux votes intervenus ce jeudi 11 décembre à l’assemblée nationale en faveur des droits des enfants. Un.e avocat.e pour chaque enfant en assistance éducative : une question d’égalité Le premier est l’adoption unanime de la proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à disposer d’un.e avocat.e dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative. Par ce vote historique, les députés valident des années de combats des anciens enfants placés et de nombreux professionnels pour que l’un des droits fondamentaux garantis par la Convention internationale des droits de l’enfant soit enfin respecté et rendu effectif. Un an après la commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques de protection de l’enfance ayant mis en lumière le caractère systémique et l’ampleur des défaillances de cette politique publique, vingt-quatre heures après la révélation d’un nouveau drame subi par un enfant sous protection institutionnelle, le vote de cette proposition de loi réaffirme que la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant réside dans le respect de ses droits et ouvre une occasion historique de changer la donne. Les avocat.e.s d’enfants sont prêt.e.s et le SAF, engagé de longue date pour la défense des droits